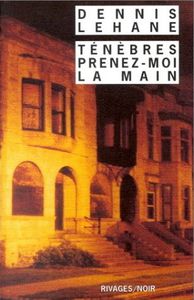LE DEMON DANS MA PEAU (THE KILLER INSIDE ME)
traduit de l’anglais par F. M. Watkins
1275 AMES (POP. 1280)
traduit de l’anglais par Marcel Duhamel
Jim Thompson
1952 et 1964
A lire aussi : Le Criminel
Ces deux romans de Jim Thompson, publiés à douze ans d’intervalle, présentent quelques points communs : le narrateur est un meurtrier. C’est aussi un flic. Et il tue sans beaucoup d’états d’âme, ce qui peut le rendre candidat à la catégorie du psychopathe. C’est déjà pas mal, comme points communs. Ajoutons quand même que l’un et l’autre travaillent dans une petite ville américaine où ils sont, en apparence du moins, intégrés à l’honnête communauté travailleuse, puisqu’ils sont carrément les garants de la loi et de l’ordre. Ils ont aussi une relation pour le moins compliquée avec les femmes : chacun d’eux en met plusieurs dans son lit mais n’en ressent aucune culpabilité, au contraire, il se sent plutôt victime du sexe faible, plus proche ici du tyran domestique, vampirique et manipulateur, que du sexe faible.
Les deux hommes ont par ailleurs en commun de ne pas savoir exactement pourquoi ils tuent. Ils le font en quelque sorte par nécessité, mais il faut interroger leur psyché pour comprendre d’où leur vient cette nécessité à laquelle ils semblent se plier – victimes, encore – en ayant le sentiment que ce n’est pas leur choix.
Lou Ford, shérif adjoint à Central City, est le narrateur de Le démon dans ma peau. Nick Corey, shérif de Pottsville, est celui de 1275 âmes (1275 dans la traduction tronquée de Marcel Duhamel, publiée en France en 1966 et rééditée plusieurs fois jusqu’en 1998, mais 1280 dans la version originale, dont une nouvelle traduction signée Jean-Paul Gratias a été publiée en 2016 par Payot & Rivages *). D’un titre à l’autre, le tueur est en quelque sorte monté en grade, ce qui augmente l’impunité avec laquelle il officie. Si Lou Ford est rapidement soupçonné puis accusé par son entourage, désigné comme un psychopathe avant la fin du roman, Nick Corey, lui, bien que soupçonné, n’est jamais vraiment puni de ses crimes et reste shérif jusqu’à la dernière page, qui ne donne aucune raison de penser qu’il ne va pas continuer de tuer pour garder son poste. Est-ce à dire qu’en 1964 Jim Thompson a perdu en espoir et gagné en cynisme, c’est-à-dire en lucidité ?
***
« Je savais que j’étais obligé de la tuer », dit le narrateur de Le démon dans ma peau. « Je pouvais en donner la raison en quelques mots. Mais chaque fois que j’y pensais, il me fallait de nouveau chercher le pourquoi. Finalement, ça me revint à l’esprit. Je n’arrivais pas à trouver un moyen de mettre mon projet à exécution car c’était plutôt duraille et je devais sans cesse me rappeler le pourquoi. Finalement, une idée me vint à l’esprit.
J’ai trouvé un moyen, parce qu’il le fallait. Je ne pouvais plus tergiverser. » (édition Folio policier 2002, p. 152)
Il arrive même que le meurtrier ait le sentiment que ce sont ses victimes qui le poussent à le tuer, voire demandent à être tuées, tant le meurtre semble être la conséquence de leur conduite :
« Pourquoi fallait-il qu’ils s’adressent tous à moi pour se faire tuer ? Ils ne pouvaient donc pas se faire ça eux-mêmes ? » (p. 158-159)
Et, quand il tue sa fiancée Lucille Stanton, avec laquelle il a joué le jeu de l’attraction-répulsion pendant la plus grande part du roman, le tueur se demande encore pourquoi tandis qu’il se tient là, debout comme un Ange de la Mort, en avatar du futur Michael Myers de Halloween :
« Elle me vit alors, planté là, sans rien dire, parce que j’avais encore oublié le pourquoi et que je cherchais à m’en souvenir. Et, finalement, ça m’est revenu.
Alors, le samedi 5 avril, un peu avant neuf heures du soir, j’ai tué Lucille Stanton.
A moins qu’on puisse appeler ça un suicide. » (p. 167)
Car Lucille Stanton, du moins dans l’esprit du tueur, a cherché sa mort, elle a provoqué ce qui lui arrive et c’est elle, au fond, qui vient recevoir ce qu’elle a tant désiré. Est-ce la raison du rire diabolique qui secoue le meurtrier à plusieurs reprises alors qu’il tue ?
Lou Ford, en tout cas, en est persuadé : il n’a pas le choix. Une nécessité le pousse, à laquelle il obéit, et il en fait une loi générale :
« On en est tous là ; si on fait ce qu’on fait, c’est qu’on ne peut pas faire autrement. » (p. 170)
L’avocat Billy Bob Walker surgit dans la dernière partie du roman pour aider le meurtrier à faire surgir une vérité tapie au fond de son inconscient. Il l’exprime à sa façon : « Vous aviez besoin de ça pour compenser le violent sentiment de culpabilité tapi au fond de votre inconscient. » (p. 215) Puis c’est Lou Ford qui formule lui-même, une analyse de son propre parcours, en faisant ressurgir le pourquoi qu’il a tant cherché, ou du moins un événement fondateur : « Mon point de départ à moi, c’était la bonne. Mon père avait tout découvert. Tous les gosses font de sacrées bêtises, surtout si quelqu’un de plus âgé les y pousse ;dans ces conditions, ça aurait pu n’avoir aucune importance. Mais l’intervention de mon père en fit un drame affreux. Il s’arrangea pour me donner l’impression que j’avais commis un acte qui ne pourrait jamais m’être pardonné, qui resterait éternellement entre lui et moi, alors qu’il était toute ma famille. Et rien de ce que je pourrais dire ou faire n’y changerait jamais rien. Il m’avait placé sur les épaules un fardeau de honte et de peur dont je ne pourrais jamais me débarrasser. » (p. 195) On comprend alors le sens d’une autre scène, quelque soixante-dix pages plus tôt : « Très vaguement, dans le lointain, j’entendis comme le mugissement d’un fantôme. C’était la sirène de la raffinerie qui annonçait le changement des équipes. Je m’imaginais les ouvriers arrivant à leur boulot et ceux de l’autre équipe qui sortaient à pas pesants. Ils jetaient leur gamelle dans leur voiture et rentraient chez eux. Ils jouaient avec leurs gosses, buvaient de la bière en regardant la télévision et sautaient leur femme… Tout à fait comme si de rien n’était. Comme si un môme n’était pas en train de mourir, et un homme, une moitié d’homme, en tout cas, en train de crever avec lui. » (p. 123) Le dérèglement de Lou Ford trouve son origine dans l’enfance, sa culpabilité dans celle des adultes qui ont irrémédiablement souillé l’enfant qu’il était, le « môme », cette « moitié d’homme », le condamnant à porter un fardeau qu’il n’a jamais pu comprendre, le poussant à reproduire toute sa vie le meurtre de la bonne qui l’avait entraîné dans le péché (le moment de la souillure est conté à demi-mots, les faits comptant moins que l’effet, Joyce Lakeland et Lucille Stanton sont des reflets de cette bonne tapie dans l’enfance), celui du père (le shérif finit par se suicider, pour de bon, lui, lorsqu’il ne peut plus supporter le poids d’une vérité qu’il pense avoir couverte des années durant) ou du fils (Elmer Conway, le fils du Vieux Conway, qu’il assassine après avoir battu à mort Joyce Lakeland, ou Johnnie Pappas, le garçon injustement accusé qu’il « suicide » dans sa cellule).
Coupable ou victime ? Lou Ford est les deux. Il tue, certes, et de façon atroce, mais une part de lui a été tuée il y a longtemps, sans qu’il en ait tout à fait conscience. Question de point de vue, selon l’avocat Billy Bob Walker, qui se souvient qu’il a découvert le fin mot de son métier dans un manuel d’agronomie : « Auparavant, tout ce que je voyais me paraissait noir ou blanc, bon ou mauvais. Mais là, j’ai appris que le nom qu’on attribue à une chose dépend de l’endroit où on est placé et de celui où la chose elle-même se trouve… D’ailleurs, voici la définition, puisée dans ce manuel d’agronomie : ‘Une mauvaise herbe est une herbe qui n’est pas à sa place.’ » (p. 214) Lou Ford est indéniablement une mauvaise herbe, mais le regard que l’on porte sur lui dépend de la position que l’on occupe. Billy Bob Walker le sait coupable et pourtant il le voit comme une victime, tourmenté par un sentiment de culpabilité qui est comme une bête tapie au fond de son inconscient.
Et si le responsable était, en dernier ressort, celui qui a fait l’homme tel qu’il est ? « J’avais tout oublié, et maintenant je résolus de tout oublier encore », déclare Lou Ford. « Il y a des choses qu’il faut oublier si l’on veut continuer à vivre. Et, je ne sais trop pourquoi, je voulais vivre. Plus que jamais. Si le bon Dieu a cafouillé en nous fabriquant, c’est quand il nous a donné envie de vivre alors qu’on n’a pas la moindre raison d’y tenir, à la vie ! » (p. 111) Mais c’est aussi en nous faisant tels que nous sommes, en permettant que soient brisés les mômes et créés les meurtriers psychopathes. Autres coupables : les gens, nous tous en général, qui ne trouvons rien à redire au monde tel qu’il est. « Nous vivons dans un monde bougrement tordu, un monde de salauds et j’ai bien peur que ça ne change pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce que personne, presque personne ne trouve rien à y redire. Ils ne voient pas que ça va mal, alors ils ne s’inquiètent pas. » (p. 122)
La vision du monde que dessine Jim Thompson à travers le point de vue de Lou Ford est une vision résolument pessimiste, que ne rachète finalement qu’un espoir ténu, formulé à la fin du roman, celui d’une rédemption dans l’autre monde : « Oui, vraiment, m’est avis que c’est tout ; à moins, espérons-le, que les gens comme nous aient encore leur chance dans l’Autre Monde. Les gens comme nous. Nous autres…
Nous tous qui avons débuté dans la vie avec une tare quelconque, nous qui désirions tant et avons obtenu si peu, nous qui, avec de si bonnes intentions, avons si mal tourné… Nous tous : moi et Joyce Lakeland, Johnnie Pappas et Bob Maples et ce brave Elmer Conway, et la petite Lucille Stanton. Oui, nous tous, souhaitons-le. » (p. 219-220) En exprimant cet espoir, le meurtrier se confond avec ses victimes, comme s’il n’y avait plus de différence, comme s’il était, une fois pour toutes, une victime lui aussi.
***
Nick Corey, le shérif de 1275 âmes, est lui aussi marqué par une enfance contrariée. Il l’évoque une fois, sans y revenir ensuite, sous forme de rêves plus que de souvenirs. « Je rêve que je suis redevenu un gosse et en même temps, j’ai pas l’impression que je rêve. Je suis un gosse, et j’habite dans le vieux bâtiment tout délabré de la plantation. Avec mon papa. Et je tâche de me trouver dans ses pattes le moins possible, mais j’y arrive jamais. Chaque fois qu’il m’attrape, il me flanque des raclées terribles.
Je rêve que je me cache derrière une porte cochère et que je crois m’être débarrassé de lui. Quand, soudain, je me sens agrippé par-derrière.
Je rêve que je pose mon déjeuner sur la table. Et que je n’arrive pas à lever les bras quand il me le jette à la figure. Je rêve que je lui montre… non, je lui montre le prix de lecture que j’ai eu à l’école. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir, et puis il faut bien que je le montre à quelqu’un. Et je rêve… non, je me retrouve par terre, après avoir reçu mon prix en pleine figure, une petite coupe d’argent qui m’a mis le nez en sang. Et lui m’injurie, en braillant que je n’irai plus à l’école parce qu’il sait, maintenant, que je suis un hypocrite, en plus de tout le reste.
En fait, il ne supporte pas que je fasse quoi que ce soit de bien. Parce qu’autrement, je ne pourrais pas être l’ignoble petit monstre qui a tué sa propre mère en venant au monde ; et il faut que je sois ça pour qu’il ait quelqu’un à blâmer. » (édition Folio policier 1998, p. 45-46)
L’humanité particulière de Nick Corey s’élargit aussitôt en humanité générale : « A l’heure qu’il est, je ne lui en veux plus guère, parce que j’en ai connu pas mal de son espèce. De ceux qui cherchent une solution facile aux problèmes compliqués. De ceux qui mettent leurs ennuis sur le dos des Juifs ou des gens de couleur. Qui ne sont pas fichus de comprendre que, dans un monde comme le nôtre, c’est forcé qu’il y ait des trucs qui ne tournent pas rond. Et en admettant qu’il y ait une réponse à la question de savoir pourquoi c’est comme ça (et il n’y en a pas toujours), eh bien, ce n’est probablement pas une seule, mais mille réponses. » (p. 46) Et le shérif de délivrer une « morale » qui dessine les contours du monde tel qu’il le voit, un monde compliqué dans lequel il est parfois vain de chercher le pourquoi. Une réponse à l’interrogation récurrente de Lou Ford qui, lui, se posait encore la question du pourquoi ?
De fait, Nick Corey ne semble plus se la poser. Au moment où on le rencontre dans l’uniforme du shérif de Pottsville, allant demander conseil à son confrère Ken Lacey qui fait respecter l’ordre dans plusieurs cantons voisins, il apparaît comme un bon bougre dont le problème principal est qu’il n’est guère respecté comme shérif. On peut le comprendre, au demeurant : Nick Corey considère que la base de son travail, la raison pour laquelle on le lui a confié, et il le répète régulièrement au long du roman, c’est de ne rien faire. Personne ne souhaite vraiment qu’il agisse en shérif, qu’il arrête les gens, qu’il traque les injustices et remplisse les cellules de la prison. Au contraire, tout le monde préfère qu’il ne fasse rien. Et il s’y applique, ça, tout le monde peut le voir : il dort beaucoup, mange beaucoup (tout en déplorant d’être toujours fatigué et de n’avoir pas le temps de manger grand-chose), se plaint de son travail et passe des journées entières à attendre que les heures passent, parfois sans même se donner la peine de se rendre au bureau et encore moins de patrouiller dans les rues de sa ville. Son principal problème, au début du roman, est d’être pris pour un imbécile par deux maquereaux qui entendent bien faire ce qu’ils veulent, ils en ont le droit d’ailleurs puisqu’ils payent le shérif pour cela. Sauf que le shérif n’apprécie pas de se voir moqué en public. C’est mauvais pour son image, et mince, il est quand même le shérif. Il ne faudrait pas que l’on se permette de mettre en question cet état de fait, qui justifie un certain respect.
Durant les six premiers chapitres, Nick Corey est ce pauvre bougre à qui l’on manque de respect et dont se moque également son confrère Ken Lacey, tout en lui donnant du shérif et des tapes dans le dos, mais aussi quelques coups de pied au cul, pour rigoler bien sûr, histoire de lui montrer comment Ken Lacey, lui, règlerait le problème des deux maquereaux. Puis vient le chapitre VII. Et le VIII, qui précise les contours du « projet » que Nick Corey mettra en œuvre dans toute la suite du roman. Quand, de retour à Pottsville, le brave mais triste Nick Corey va directement trouver les deux maquereaux et les refroidit proprement, sans état d’âme, avant de jeter leurs corps dans le fleuve, on se dit soit que le brave gars a changé d’un coup, soit qu’il nous a dupés pendant six chapitres, en se faisant passer pour un couillon. Et on ne tarde pas à comprendre que c’est bel et bien la seconde option qui est la bonne. Nick Corey nous a dupés comme il a dupé tout le monde, ou s’apprête à le faire. Dans les grandes largeurs.
Passons sur les détails, le lecteur ira les découvrir lui-même en parcourant d’un œil fiévreux les quelque 250 pages de 1275 âmes. Donnons plutôt la parole à ce brave shérif, chapitre VIII : « Et je suis obligé de digérer ça sans rien dire pour le moment. Mais ça viendra bien un jour. » (p. 64) Manifestement, le jour est venu.
Car Corey ne se contente pas de prendre dans ses filets cette grande gueule de Ken Lacey qui l’a pris pour un demeuré et qui comprend, trop tard, qu’il s’est fait mener par le bout du nez. A tant chanter sa perspicacité il n’a rien vu venir, et ce n’est pas le lecteur qui le prendra en pitié. Et tel est bien le projet de ce livre : les gens à qui Corey s’en prend au fil des chapitres n’ont rien de sympathique et l’on est aisément tenté de donner raison à l’homme qui met en œuvre le juste châtiment de leur fourberie. Donc à prendre le parti du shérif, d’autant que c’est lui qui raconte l’histoire. Pleurer sur le sort des deux maquereaux et du shérif vantard, méprisant et condescendant ? Pourquoi diable ? Non que l’on trouve beaucoup plus sympathique le shérif lui-même, mais comme on est dans sa tête on peut avoir tendance à le comprendre, sinon à justifier tout ce qu’il fait. Les chapitres VII et VIII ne sont qu’un début. Nick est aussi flanqué d’une femme acariâtre elle-même flanquée d’un frère demeuré dont on soupçonne (avec le shérif, évidemment) qu’il n’est peut-être pas si frère que cela, et que tout demeuré qu’il est, épiant les dames de Pottsville par les fenêtres de leur maison, il n’est peut-être pas non plus un inoffensif impuissant. Et puis il y a Rose et Amy : la première est la maîtresse du shérif, mariée à une brute ivrogne et agressive, la seconde est l’ancienne fiancée, que Nick était sur le point d’épouser quand il s’est fait mettre le grappin dessus par l’acariâtre Myra, qui l’a forcé à l’épouser pour échapper à une accusation de viol qui, à l’époque, se serait résolue en lynchage pur et simple par une populace en colère. Compliqué ? Peut-être mais pas tant que cela. Nick reprend sa liaison avec Amy tout en esquivant les attaques de sa mégère domestique et en composant avec la sexualité insatiable de Rose.
On devine comment le shérif décide de mettre dans l’ordre dans ce joyeux bordel, et le roman met en scène les étapes de ce qu’il faut bien appeler un projet patiemment élaboré, tout à fait conscient et prémédité. A travers les relations de Nick Corey avec son entourage, c’est une vision du monde qui se révèle : « Parce que, entre nous, des convictions, il ne m’en reste plus guère. » (p. 71) Ni sur ses proches ni sur les habitants de Pottsville, « charmante » petite ville peuplée d’hypocrites et, disons-le d’un mot, de coupables. Il suffit au shérif de suggérer quelque vilenie pour que les bons notables baissent le nez, préférant laisser faire le shérif, tout incapable qu’il soit, plutôt que de risquer de voir étalées leurs turpitudes sur la place publique. En quoi ils confirment ce qu’il pense déjà : on ne le paye pas pour dévoiler des vérités mais pour fermer les yeux et ne rien faire. A Robert Lee Jefferson, l’attorney général du canton, quincaillier de son métier, qui s’indigne : « Nick, combien de temps crois-tu pouvoir continuer comme ça ? A ne faire strictement rien ? Tu t’imagines vraiment que ça peut durer ? Tu touches des pots-de-vin, tu voles le canton et tu ne fais rien pour gagner ta paie. », il répond : « Mais justement, si je veux garder ma place, je ne vois pas comment je pourrais en faire plus ! » (p. 77) Et de terminer en faisant son auto-portrait, qui démontre qu’en effet il n’a plus guère de convictions, ni d’illusions : « D’abord, je suis ni honnête, ni courageux, ni travailleur. Et ensuite, les électeurs ne tiennent pas à ce que je le sois. » (p. 78) Même son de cloche quelques chapitres plus loin, dans un dialogue avec sa femme Myra : « Va travailler un peu, pour changer ! – Moi ? Je travaille tout le temps. – Toi ? Pauvre moule, pauvre idiot ! Jamais tu ne fais rien ! – Justement, c’est ça, mon boulot : ne rien faire. C’est comme ça que les gens votent pour moi. » (p. 143) Même quand il discrédite son adversaire aux élections, l’honnête Sam Gaddis, en lançant des rumeurs qui ont vite fait de se propager et de s’amplifier (car, à la vérité, il n’a eu qu’à suggérer des turpitudes cachées, ce sont les gens ensuite qui ont inventé lesdites turpitudes, puisant dans leurs propres fantasmes), le shérif, littéralement, ne fait rien et se dit attristé, « sincèrement » (p. 91), par la nature de ses concitoyens, capables d’inventer des horreurs sans nom et de les colporter sans aucune vergogne. Il n’a pas à faire le travail : les « honnêtes » citoyens le font pour lui.
Une phrase, au détour d’un chapitre, rappelle l’obscure parenté entre Nick Corey et Lou Ford, le policier psychopathe de Le démon dans ma peau : « Ça peut paraître insensé qu’on fasse des choses sans savoir pourquoi, et pourtant, durant presque toute mon existence, c’est ce qui s’est passé. » (p. 100) Comme Lou Ford, Nick Corey a le sentiment de donner à ses victimes ce qu’elles ont bien cherché, et qu’elles méritent, même s’il prétend ne pas savoir pourquoi il agit ainsi. C’est comme une évidence, la conséquence naturelle d’un trop-plein. Ou d’un relativisme qui est le pendant moral d’une éthique de vie définie par une paresse presque professionnelle, elle-même conséquence d’une vision pessimiste de l’humanité qui l’entoure. « Il faut que ce soit fait, pas d’histoires. D’abord, j’ai pas le choix. Moi, j’aurais volontiers laissé courir, endurant de nature comme je suis. Mais il a fallu qu’ils me forcent la main. » (p. 215) Amy, l’ancienne fiancée, aussi raffinée que Rose est une bête sexuelle, a connu un Nick Corey lui aussi plus raffiné, et elle s’étonne de sa transformation : « Tu as de l’éducation, Nick. Pourquoi parles-tu comme un illettré ? » A quoi il répond, fataliste : « L’habitude, j’imagine. On s’encroûte, à force. La langue et la grammaire, c’est comme le reste, ça se rouille. On s’en sert pas – puisqu’il y a pas vraiment de demande – alors on tarde pas à perdre la main. Le bien et le mal, par exemple, on finit par plus savoir ce qu’est l’un et ce qu’est l’autre. » (p. 108) Aveu, ou constat, de décrépitude morale qui affecte tous les aspects de l’existence, de la façade à l’intérieur. Gâchis, aussi, qui rappelle les questions que posait le shérif Maples à Lou Ford dans Le démon dans ma peau : « Pourquoi es-tu resté si longtemps ici ? Pourquoi as-tu voulu porter l’insigne ? Pourquoi n’es-tu pas devenu médecin comme ton papa ? Tu aurais quand même pu faire quelque chose de mieux que ça, dans ta vie ! » (p. 132) Nick Corey et Lou Ford sont deux exemples de promesses non tenues, d’espoirs non réalisés, de capacités brisées ou laissées à l’abandon. Chez l’un comme chez l’autre, le meurtre est le résultat d’une déchéance, ramenée dans Le démon dans ma peau à un traumatisme originel mais, dans 1275 âmes, expliquée davantage par un abandon résigné, une sorte de soumission à un « ordre » extérieur qui n’est rien d’autre que la pauvreté sans fond de l’homme.
Nick Corey a une conscience claire de ce qu’il fait. Et il assume. « Je n’aime que moi, sacré bon sang, et je continuerai à mentir, à tromper, à boire, à forniquer et à aller à l’église le dimanche avec tous les gens respectables. » (p. 138) Cynique, le shérif ? « Je voudrais te poser une seule question », dit encore Robert Lee, l’attorney général. « As-tu, oui ou non, l’intention de commencer à faire respecter la loi ? – Pour sûr ! Je vais m’y mettre carrément, même ! – Enfin, je suis soulagé de te l’entendre dire ! – Parfaitement ! Ce coup-ci, je vais sévir pour de bon ! A partir de maintenant, tous les délinquants auront affaire à moi. A condition, bien sûr, qu’ils soient ou bien des gens de couleur, ou bien de la pauvre racaille de Blancs, enfin, de ceux qu’ont pas de quoi se payer une carte d’électeur. – Voilà une déclaration bien cynique. – Cynique ? Oh ! voyons, Robert Lee ? Quelle raison je pourrais bien avoir d’être cynique ? » (p. 178)
Au fil des pages, la connivence initiale du meurtrier et du lecteur est mise à mal. Car Nick Corey fait aussi des victimes innocentes – si tant est que l’on adhère d’abord à l’idée que ses premières victimes ont mérité leur sort. Une fois qu’il a commencé à tuer, rien ne semble plus pouvoir l’arrêter et il se met à présenter lui-même ses actes comme une mission rien moins que divine. Le personnage bascule alors dans une forme de folie qui le rapproche du Lou Ford de Le démon dans ma peau. « C’est mon métier, oublie pas, de punir les gens pour le simple fait qu’ils sont des êtres humains », dit-il à Rose. « De les amadouer jusqu’à ce qu’ils se montrent tels qu’i’ sont et ensuite de leur tomber dessus. Et c’est un sale boulot, figure-toi, mon loup, et j’estime que le plaisir que je peux trouver à les piéger, je l’ai bougrement mérité. » (p. 234) Il ne s’agit plus de dire que les « autres » le forcent à tuer, mais qu’il existe une sorte de nécessité transcendante qui l’oblige à agir ainsi. Cette nécessité ne tarde plus, alors, à recevoir un nom : « Faut que je continue à être le shérif du canton de Potts pour obéir au Seigneur, pour Le servir, et tout ce qu’i’ fait, Rose, c’est de me désigner les pécheurs, et, moi, j’exerce Ses représailles contre eux. Et je vais te dire un secret, Rose : Bien des fois, je suis pas du tout d’accord avec Lui. » (p. 237-238) Au terme de cette tirade hallucinée, Corey en fournit lui-même l’explication, désespérée : « J’ai mis longtemps à faire le point mais maintenant, ça y est : j’ai finalement trouvé une explication aux choses, parce qu’il fallait que je la trouve, Rose, sans ça, je serais devenu fou. » (p. 239) Et, en dernier ressort, il balaie les doutes qu’il peut encore avoir, car il y va de sa survie, de sa santé mentale : de la folie comme ultime rempart de la santé d’esprit. Il finit par y croire lui-même et trouver dans la prière le renfort à l’action : « J’ai prié avec ferveur et bientôt je me suis repris et mes doutes se sont envolés. J’ai prié de toute mon âme et ma force m’a été rendue (…) »
Un moment de révélation survient juste avant cette confession, moment qui fait écho à la scène de Le démon dans ma peau (p. 123) où le narrateur entrait dans les maisons des ouvriers pour avoir la vision de leur vie ordinaire, où les mômes crevaient dans l’indifférence générale. Ici, c’est Nick Corey qui a la soudaine révélation du vide : « Je suis entré dans cette maison, dans celle-ci et dans des douzaines d’autres pareilles, peut-être plus de cent fois. Mais jamais auparavant je n’avais réalisé ce qu’elles sont. Pas des foyers, pas des endroits où les gens peuvent vivre, non. Exactement rien. Des planches de sapin assemblées autour du vide. Pas de tableaux, pas de livres – rien à regarder, rien pour s’occuper le cerveau. Que du vide, un vide qui, petit à petit, s’infiltre en moi.
Et, tout d’un coup, ce vide n’est pas seulement ici, il est partout, dans toutes les maisons. Et en même temps, il se remplit de bruit, de visions et de fureur, de toutes les choses affreuses et sinistres que ce vide a provoquées.
Les pauvres petites filles sans défense qui pleurent en voyant leur père se glisser dans leur lit. Les hommes qui battent leurs femmes et les femmes qui hurlent des supplications. Les gosses qui pissent au lit, d’angoisse et de peur, et leurs mères qui les punissent en les aspergeant de poivre rouge. Les visages hâves, hagards, ravagés par le ténia et le scorbut. La sous-alimentation, les dettes toujours plus fortes que le crédit. La hantise, comment on va manger, où on va dormir, comment on va couvrir nos pauvres culs tout nus. Le genre d’obsession qui fait que, quand on n’a rien d’autre dans la tête, mieux vaut être mort. Parce que c’est le vide des idées, quand on est déjà mort en dedans, et qu’on ne fait plus que répandre la saloperie, la terreur, les larmes, les cris, la torture, la faim et la honte de sa propre mort. De son propre vide.
Je frissonne, en songeant à la grande bonté du Seigneur qui a créé tant d’abominations dans ce monde, afin qu’une chose comme un meurtre paraisse bien bénigne en comparaison. Non, vraiment, c’est miséricordieux, c’est merveilleux de Sa part. » (p. 225-226)
Vision des Enfers par le truchement d’une fenêtre. Mais cet enfer, c’est le monde tel qu’il est, tel en tout cas que le voit Nick Corey, influencé par une Amérique de la Dépression (le roman a été publié en 1964 mais on s’y déplace en carrioles à cheval et l’on vit dans des maisons de bois ici comparées à des cercueils vides) mais extensible à l’humanité de tous les temps. Misère, souffrance, dénuement, cris, hurlements, désespoir. Après une telle révélation, quelle issue ? Pour Corey, c’est la mission divine. Et de le réaffirmer dans la dernière page du roman : « Sans ça, pour l’amour du Ciel, pour l’amour de Dieu, pourquoi est-ce que j’aurais été mis ici, dans le canton de Potts, et pourquoi j’y resterais ? C’est l’évidence même. Qui d’autre que le Christ tout-puissant serait capable de supporter une chose pareille ? » (p. 248) Le shérif psychopathe devient rien moins que le Christ, envoyé sur la Terre pour laver les péchés de l’humanité, en commençant par les endosser. Car s’il a une certitude à la fin du roman, c’est celle-ci : « J’ai réfléchi, réfléchi et réfléchi encore et, finalement, j’y suis arrivé : j’ai décidé que je sais pas plus ce que je dois faire que n’importe quel autre minable échantillon de l’espèce humaine. » (p. 248)
Et si le ton de 1275 âmes est aussi allègre que désespéré, c’est peut-être parce qu’il n’y a plus rien d’autre à faire, quand on a de la vie cette vision terrifiante et sans appel. Est-ce Nick Corey ou Jim Thompson qui s’écrie : « Et qu’est-ce qu’on peut faire d’autre, à part rigoler et blaguer… Comment, autrement, supporterait-on l’insupportable ? » (p. 209-210)
Thierry LE PEUT
21 décembre 2021, 10 h 08 – 13 h 14
* Hélas, cher lecteur, c’est la traduction de Marcel Duhamel que j’ai lue, car ces lectures se font au gré des rencontres, et c’est en Folio policier que j’ai découvert 1275 âmes. J.P. Gratias, un jour peut-être, tu finiras sur mon étagère !
/image%2F1605438%2F20220819%2Fob_690c0a_anderson-la-patrouille-du-temps.jpg)
/image%2F1605438%2F20220819%2Fob_b42a1c_anderson-la-patrouille-du-temps-2.jpg)
/image%2F1605438%2F20220819%2Fob_ae87c6_anderson-la-patrouille-du-temps-4.jpg)
/image%2F1605438%2F20220819%2Fob_fdf561_anderson-la-patrouille-du-temps-3.jpg)



/image%2F1605438%2F20220806%2Fob_3695cc_kelley-un-autre-tambour-3-bis.jpg)
/image%2F1605438%2F20220806%2Fob_4a85ff_kelley-un-autre-tambour-1.jpg)
/image%2F1605438%2F20220806%2Fob_fc5115_kelley-un-autre-tambour-2.jpg)
/image%2F1605438%2F20211231%2Fob_088de0_zelazny-les-neuf-princes-d-ambre.jpg)
/image%2F1605438%2F20211231%2Fob_a8659b_zelazny-les-neuf-princes-d-ambre-2.jpg)
/image%2F1605438%2F20211231%2Fob_ee18e9_zelazny-les-neuf-princes-d-ambre-3.jpg)
/image%2F1605438%2F20211221%2Fob_e29ec8_thompson-le-demon-dans-ma-peau.jpg)
/image%2F1605438%2F20211221%2Fob_abaa0e_thompson-1275-ames.jpg)
/image%2F1605438%2F20211212%2Fob_4eb779_thompson-le-criminel.jpg)
/image%2F1605438%2F20211108%2Fob_3a3c83_spinrad-avaleurs-de-vide.jpg)