LES CATILINAIRES, d'Amélie Nothomb
Albin Michel, 1995 - Livre de Poche, 1997
Conte cruel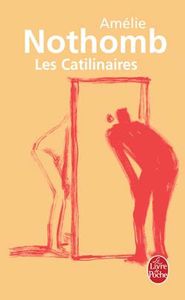 Emile et Juliette Hazel achètent une petite maison à la campagne. Pour y finir leurs jours tranquilles, après une vie entière passée ensemble. Seul hic : ce lieu idyllique est vendu avec un voisin, Palamède Bernardin. Un médecin sans patients, qui vient frapper à la porte un jour à quatre heures, s’installe dans un fauteuil jusqu’à six heures, répondant par des « oui » et des « non » à toutes les questions, l’air perpétuellement fâché. Et chaque jour il revient. Pour n’avoir pas osé l’éconduire, Emile et Juliette découvrent qu’il suffit d’un incident pour transformer leur rêve de thébaïde en cauchemar journalier.
Emile et Juliette Hazel achètent une petite maison à la campagne. Pour y finir leurs jours tranquilles, après une vie entière passée ensemble. Seul hic : ce lieu idyllique est vendu avec un voisin, Palamède Bernardin. Un médecin sans patients, qui vient frapper à la porte un jour à quatre heures, s’installe dans un fauteuil jusqu’à six heures, répondant par des « oui » et des « non » à toutes les questions, l’air perpétuellement fâché. Et chaque jour il revient. Pour n’avoir pas osé l’éconduire, Emile et Juliette découvrent qu’il suffit d’un incident pour transformer leur rêve de thébaïde en cauchemar journalier.
Les Catilinaires possède la légèreté, la vitalité et la cruauté des romans d’Amélie Nothomb. C’est une comédie noire, peuplée de personnages banals ou inquiétants, le docteur et son épouse tirant bientôt le récit vers l’absurde fantastique, le « bizarre », d’autant plus terrifiant qu’il est cocasse et qu’il s’installe sans prévenir dans la vie des deux personnages principaux. En faisant de son « héros » Emile un professeur de latin et de grec à la retraite, Amélie Nothomb s’autorise le plaisir d’inviter la culture classique à la fête, invoquant finalement les discours de Cicéron dans une conclusion simplement cruelle, ou cruellement simple. L’histoire, reposant sur le postulat lui-même classique d’une intrusion tournant au cauchemar, est déroulée avec une évidence psychologique qui fait des personnages des types mythologiques (c’est l’auteur qui le suggère), donnant une portée générale à l’aventure d’Emile et Juliette.
Si le docteur Bernardin et son épouse sont inquiétants, la cruauté se love plutôt, pourtant, dans les protagonistes, ce couple de retraités placides qui n’aspire qu’au bonheur solitaire et tranquille mais voit celui-ci irrémédiablement contrarié par le viol quotidien de son intimité. Comme souvent chez Amélie Nothomb, l’unité de lieu renforce le caractère implacable de l’intrigue, accentuant l’enfermement des personnages dans une logique qui met au jour leur vérité profonde et ne leur laisse guère le choix de leurs actes. Le narrateur est Emile, qui raconte après coup, quelques mois après les faits, et à qui revient la responsabilité de « conclure » l’aventure par un acte extrême : un acte aux antipodes du personnage qu’il croyait être, mais implacable, justement, par sa logique. Le bonheur retrouvé est au prix de la dissimulation, à jamais. « On ne sait rien de soi » est la première phrase qu’il écrit, au début de son récit. Car Les Catilinaires est tout bêtement un récit « de passage », dont le héros n’est pas un adolescent accomplissant son entrée dans la vie adulte, mais un vieillard découvrant sur lui-même une vérité insoupçonnée, à l’automne de sa vie.
La cruauté est aussi le fait de l’auteur. La manière dont elle décrit le médecin, et surtout son épouse, tout droit vomie d’un sketch des Monty Python ou d’un film de Guillermo del Toro, est un grand moment de cruauté assumée dont Nothomb réussit parfaitement à rendre complice le lecteur. Avant, toutefois, de mettre en scène un processus de compassion qui, s’il ne sauve pas les personnages, permet une fin « morale », non dénuée de surprise. Chacun appréciera.
Thierry LE PEUT



 Le nez à la fenêtre
Le nez à la fenêtre On me pardonnera le titre ci-dessus : ce sont en fait les derniers mots de la préface de Claire Debru, qui présente chez l'éditeur Allia le fabliau traduit de l'ancien français. Vous lirez la préface pour mieux comprendre comment C. Debru en arrive là.
On me pardonnera le titre ci-dessus : ce sont en fait les derniers mots de la préface de Claire Debru, qui présente chez l'éditeur Allia le fabliau traduit de l'ancien français. Vous lirez la préface pour mieux comprendre comment C. Debru en arrive là.
 Le haïku est un genre littéraire japonais. Il s'agit d'un court poème composé de trois vers et de dix-sept syllabes. Pas une de plus."
Le haïku est un genre littéraire japonais. Il s'agit d'un court poème composé de trois vers et de dix-sept syllabes. Pas une de plus."