Eldorado Films, 1973
Un giallo anglais
 Dès les premières images du film, la mise en scène impose une distance qui invite à saisir les images comme des signes précurseurs. Le montage parallèle qui suit la petite fille en rouge se promenant près d’un étang, le petit garçon à vélo et les parents occupés à l’intérieur de leur maison suscite immédiatement l’attente d’un drame, que l’on n’identifie pas forcément si l’on découvre le film sans connaissance préalable ou de son synopsis ou de l’affiche montrant Donald Sutherland tenant dans ses bras le petit corps sans vie. Le drame, en effet, peut choisir comme victime l’un ou l’autre des enfants, et l’idée peut naître que
Dès les premières images du film, la mise en scène impose une distance qui invite à saisir les images comme des signes précurseurs. Le montage parallèle qui suit la petite fille en rouge se promenant près d’un étang, le petit garçon à vélo et les parents occupés à l’intérieur de leur maison suscite immédiatement l’attente d’un drame, que l’on n’identifie pas forcément si l’on découvre le film sans connaissance préalable ou de son synopsis ou de l’affiche montrant Donald Sutherland tenant dans ses bras le petit corps sans vie. Le drame, en effet, peut choisir comme victime l’un ou l’autre des enfants, et l’idée peut naître que  l’un d’eux sera non la victime mais l’auteur du drame. Cette séquence d’ouverture porte en fait en abyme l’ensemble du film, où une multitude de signes annonce la fin, peu à peu explicitée. Lorsque celle-ci survient, le réalisateur rappelle ces signes en les reparcourant à grande vitesse, sous forme de flashs, invitant à une nouvelle vision, cette fois informée. Nicolas Roeg impose de la sorte à l’esprit du spectateur la construction de son scénario, tendu vers son dénouement, alors même que l’action du film donnera bientôt l’impression de traîner en longueur, tardant à révéler un enjeu clairement identifié.
l’un d’eux sera non la victime mais l’auteur du drame. Cette séquence d’ouverture porte en fait en abyme l’ensemble du film, où une multitude de signes annonce la fin, peu à peu explicitée. Lorsque celle-ci survient, le réalisateur rappelle ces signes en les reparcourant à grande vitesse, sous forme de flashs, invitant à une nouvelle vision, cette fois informée. Nicolas Roeg impose de la sorte à l’esprit du spectateur la construction de son scénario, tendu vers son dénouement, alors même que l’action du film donnera bientôt l’impression de traîner en longueur, tardant à révéler un enjeu clairement identifié.
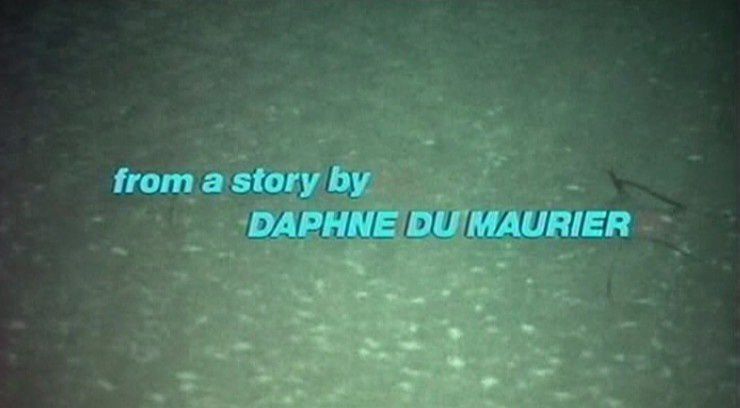
On hésite en effet à déceler l’enjeu du récit. La séquence liminaire, par son montage et ses effets, tant visuels que sonores (mise en valeur de certains sons, déformation de l’image et du son par le ralenti), s’offre comme une scène revécue, comme si le propos de Nicolas Roeg n’était pas de raconter le drame mais d’abord de le mettre en scène comme un moment fondateur, tel qu’il sera ou a été ensuite revécu des centaines de fois dans l’esprit des parents. La scène est ainsi restituée à travers un prisme déformant qui peut être celui de la mémoire des parents, protagonistes du film. Son impact ne sera pas développé de manière diégétique, une ellipse importante séparant la séquence liminaire de la suite du film, où l’on retrouve les parents à Venise, bien après le drame ; il sera suggéré par le dialogue, qui mettra l’accent sur la culpabilité du père, à partir de laquelle toute la séquence du drame peut être lue.
 Le caractère inéluctable du drame apparaît ainsi non seulement comme un travail de mise en scène mais comme le résultat du travail de mémoire du père. Le pressentiment qu’il a du drame, en observant un détail d’une diapositive qu’il est en train de manipuler, peut ainsi être lu comme une reconstruction a posteriori : non pas un pressentiment réellement survenu avant le drame mais la traduction du sentiment de culpabilité du père, qui pense qu’il aurait dû anticiper ce qui allait se produire.
Le caractère inéluctable du drame apparaît ainsi non seulement comme un travail de mise en scène mais comme le résultat du travail de mémoire du père. Le pressentiment qu’il a du drame, en observant un détail d’une diapositive qu’il est en train de manipuler, peut ainsi être lu comme une reconstruction a posteriori : non pas un pressentiment réellement survenu avant le drame mais la traduction du sentiment de culpabilité du père, qui pense qu’il aurait dû anticiper ce qui allait se produire.
Cette tension entre mise en scène – c’est le réalisateur qui  nous manipule – et narration subjective – nous sommes en fait dans la tête du père – est constante dans le film. Au point qu’on soupçonne plus tard le père de n’être pas aussi innocent qu’il le paraît, de dissimuler une part d’ombre, peut-être une double personnalité. Et que l’on soupçonne, aussi, le film de nous avoir entraîné sur de fausses pistes en nous faisant partager l’illusion de Sutherland plutôt que la réalité. Ce sentiment s’affirme avec la scène du bateau mortuaire sur lequel Sutherland voit sa femme pourtant partie le matin même de Venise vers l’Angleterre. Brusquement ce que l’on prenait pour la réalité est mis en doute, et l’on se demande si le récit n’a pas été manipulé ou déformé par Sutherland. Qu’il ne comprenne pas lui-même ne fait qu’imposer l’idée qu’il puisse être lui-même victime de l’illusion, que sa personnalité soit double.
nous manipule – et narration subjective – nous sommes en fait dans la tête du père – est constante dans le film. Au point qu’on soupçonne plus tard le père de n’être pas aussi innocent qu’il le paraît, de dissimuler une part d’ombre, peut-être une double personnalité. Et que l’on soupçonne, aussi, le film de nous avoir entraîné sur de fausses pistes en nous faisant partager l’illusion de Sutherland plutôt que la réalité. Ce sentiment s’affirme avec la scène du bateau mortuaire sur lequel Sutherland voit sa femme pourtant partie le matin même de Venise vers l’Angleterre. Brusquement ce que l’on prenait pour la réalité est mis en doute, et l’on se demande si le récit n’a pas été manipulé ou déformé par Sutherland. Qu’il ne comprenne pas lui-même ne fait qu’imposer l’idée qu’il puisse être lui-même victime de l’illusion, que sa personnalité soit double.
 Par la juxtaposition d’images « bizarres », qui semblent suggérer une vérité cachée, comme celle des deux sœurs anglaises riant aux éclats devant un miroir et une galerie de photographies, Roeg entretient les fausses pistes, maintient son récit dans une incertitude qui suscite l’inquiétude du spectateur, l’empêchant de savoir à quoi s’attendre. L’enjeu du récit est-il de montrer les conséquences du drame liminaire sur les parents ? Ou s’agit-il d’un récit fantastique, dont la voyance et le contact avec l’au-delà seront l’argument principal ? Ou cette dimension fantastique n’est-elle qu’un leurre, le centre du récit étant en fait l’imposture, c’est-à-dire la manipulation ? Roeg maintient longtemps cette incertitude en ouvrant les différentes pistes et en déroulant lentement son récit, sans l’engager explicitement dans l’une ou l’autre piste. Cette fois, la séquence qui porte en abyme cette incertitude est celle du couple Sutherland – Christie errant dans les rues sombres de Venise sans parvenir à trouver leur chemin, pour finalement revenir à leur point de départ. L’errance elle-même les aura entretemps mis au contact de sensations étranges, aura fait naître chez le spectateur la (fausse) prescience d’un drame. L’« apparition » de la forme rouge, évoquant la petite fille – toujours dans l’esprit du père, qui est seul à la « voir » -, se révélera elle-même, dans le finale, comme une fausse piste, mais une fausse piste fondée sur l’obsession du père et conduisant à un nouveau drame bien réel. L’image « réelle » de la forme rouge dans le dénouement ne sera ainsi que la vision déformée de ce que traquait Sutherland, une vision horrible déjouant in extremis l’attente suscitée dans l’esprit du père mais aussi dans celui du spectateur. Parvenu à la fin du film, on se convainc que ce n’est pas seulement la séquence liminaire du drame mais le film tout entier qui est une recréation a posteriori issue de l’esprit du père, ce que suggère une fois encore la série de flashs par lesquels Sutherland revoit en accéléré les événements qui ont conduit au dénouement.
Par la juxtaposition d’images « bizarres », qui semblent suggérer une vérité cachée, comme celle des deux sœurs anglaises riant aux éclats devant un miroir et une galerie de photographies, Roeg entretient les fausses pistes, maintient son récit dans une incertitude qui suscite l’inquiétude du spectateur, l’empêchant de savoir à quoi s’attendre. L’enjeu du récit est-il de montrer les conséquences du drame liminaire sur les parents ? Ou s’agit-il d’un récit fantastique, dont la voyance et le contact avec l’au-delà seront l’argument principal ? Ou cette dimension fantastique n’est-elle qu’un leurre, le centre du récit étant en fait l’imposture, c’est-à-dire la manipulation ? Roeg maintient longtemps cette incertitude en ouvrant les différentes pistes et en déroulant lentement son récit, sans l’engager explicitement dans l’une ou l’autre piste. Cette fois, la séquence qui porte en abyme cette incertitude est celle du couple Sutherland – Christie errant dans les rues sombres de Venise sans parvenir à trouver leur chemin, pour finalement revenir à leur point de départ. L’errance elle-même les aura entretemps mis au contact de sensations étranges, aura fait naître chez le spectateur la (fausse) prescience d’un drame. L’« apparition » de la forme rouge, évoquant la petite fille – toujours dans l’esprit du père, qui est seul à la « voir » -, se révélera elle-même, dans le finale, comme une fausse piste, mais une fausse piste fondée sur l’obsession du père et conduisant à un nouveau drame bien réel. L’image « réelle » de la forme rouge dans le dénouement ne sera ainsi que la vision déformée de ce que traquait Sutherland, une vision horrible déjouant in extremis l’attente suscitée dans l’esprit du père mais aussi dans celui du spectateur. Parvenu à la fin du film, on se convainc que ce n’est pas seulement la séquence liminaire du drame mais le film tout entier qui est une recréation a posteriori issue de l’esprit du père, ce que suggère une fois encore la série de flashs par lesquels Sutherland revoit en accéléré les événements qui ont conduit au dénouement.
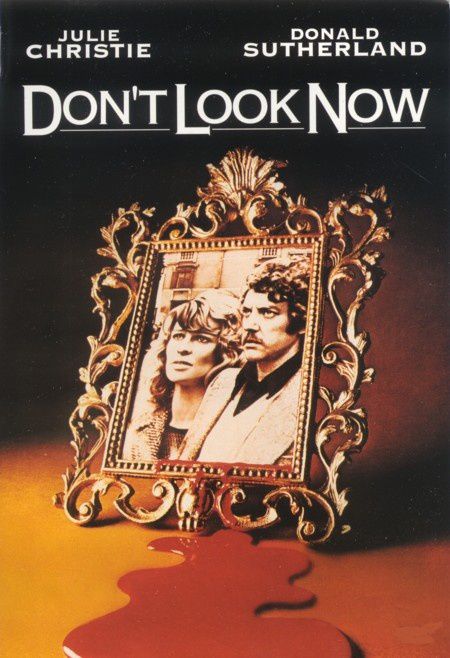 Rares sont les personnages du film qui échappent à l’ambiguïté. Les deux sœurs anglaises, bien sûr, dont les deux gérantes de l’hôtel semblent les reflets, portant des lunettes noires qui évoquent la cécité de l’une des Anglaises. Mais le cardinal, aussi, qui porte sur les gens et les événements un regard étrangement « conscient », comme s’il voyait au-delà des apparences, et en particulier sur Donald Sutherland. Le commissaire de police, filmé en contre-plongée, à la fois présent et curieusement absent, comme s’il connaissait la vérité que Sutherland ignore, qu’il n’était pas dupe du récit de ce dernier. Le directeur de l’internat anglais et sa femme, dont le comportement suggère, là encore, une connaissance ou une motivation secrète. Toujours, ces personnages apparaissent non pas de manière réaliste, objective, mais à travers le prisme du soupçon qui déforme toutes les images du film. Ils sont aussi étranges et inquiétants que les statues qui peuplent le décor du film, à l’instar du Saint Nicolas (?) que Sutherland remet en place sur la façade de l’église qu’il restaure, et qu’on s’attendrait à voir s’animer. Ils expriment tous une duplicité qui imprègne l’ensemble du métrage, dont on ne parvient jamais à se défaire. A travers eux, Roeg s’ingénie à créer des attentes qu’il trompe ensuite : artifice de mise en scène ou traduction de la vision du monde du personnage incarné par Sutherland ?
Rares sont les personnages du film qui échappent à l’ambiguïté. Les deux sœurs anglaises, bien sûr, dont les deux gérantes de l’hôtel semblent les reflets, portant des lunettes noires qui évoquent la cécité de l’une des Anglaises. Mais le cardinal, aussi, qui porte sur les gens et les événements un regard étrangement « conscient », comme s’il voyait au-delà des apparences, et en particulier sur Donald Sutherland. Le commissaire de police, filmé en contre-plongée, à la fois présent et curieusement absent, comme s’il connaissait la vérité que Sutherland ignore, qu’il n’était pas dupe du récit de ce dernier. Le directeur de l’internat anglais et sa femme, dont le comportement suggère, là encore, une connaissance ou une motivation secrète. Toujours, ces personnages apparaissent non pas de manière réaliste, objective, mais à travers le prisme du soupçon qui déforme toutes les images du film. Ils sont aussi étranges et inquiétants que les statues qui peuplent le décor du film, à l’instar du Saint Nicolas (?) que Sutherland remet en place sur la façade de l’église qu’il restaure, et qu’on s’attendrait à voir s’animer. Ils expriment tous une duplicité qui imprègne l’ensemble du métrage, dont on ne parvient jamais à se défaire. A travers eux, Roeg s’ingénie à créer des attentes qu’il trompe ensuite : artifice de mise en scène ou traduction de la vision du monde du personnage incarné par Sutherland ?
Le décor n’est pas moins essentiel que les personnages. Il est souvent, d’ailleurs, curieusement désert. C’est la Venise de la fin de la saison touristique, alors que les hôtels ferment. Une Venise qui se vide et qu’il faut restaurer, tant elle court le risque d’être engloutie par les eaux sur lesquelles elle repose. Une Venise de carte postale, sans doute, mais qui recèle un dédale de ruelles à la destination incertaine, et où l’errance de Sutherland s’achèvera dans une sorte d’enfer, au-delà de la « porte du Diable ».
 L’esthétique du film évoque le giallo, ne serait-ce que par son rythme lent traversé de fulgurances chromatiques. Le rouge, présent du début à la fin du métrage, domine ces fulgurances et se résout finalement dans l’écoulement d’un sang épais, d’un rouge peu réaliste, dont la forme épouse parfaitement l’écoulement « fantastique » apparu sur la diapositive de la séquence liminaire. La musique de Pino Donaggio achève de tisser un lien puissant entre l’Angleterre où commence le film et l’Italie où il se referme. TLP
L’esthétique du film évoque le giallo, ne serait-ce que par son rythme lent traversé de fulgurances chromatiques. Le rouge, présent du début à la fin du métrage, domine ces fulgurances et se résout finalement dans l’écoulement d’un sang épais, d’un rouge peu réaliste, dont la forme épouse parfaitement l’écoulement « fantastique » apparu sur la diapositive de la séquence liminaire. La musique de Pino Donaggio achève de tisser un lien puissant entre l’Angleterre où commence le film et l’Italie où il se referme. TLP


