DIX HEURES ET DEMIE DU SOIR EN ETE, par Marguerite Duras
Gallimard, 1960
Enivrant et fascinant
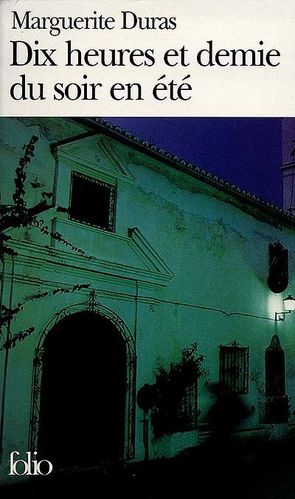 Dans une petite ville d’Espagne où des touristes sont bloqués par l’orage, un meurtre a été commis. Maria, son mari Pierre, leur fille Judith, leur amie Claire sont parmi les touristes. Ils doivent se rendre à Madrid, mais l’orage les force à attendre le lendemain. Ils auront le temps, sans doute, autant en profiter, de s’arrêter pour voir trois Goya dans une église. Pierre y tient, Maria non. Maria boit beaucoup. C’est ainsi, toujours. Un meurtre a été commis. C’est Rodrigo Paestra qui a tué sa jeune femme de dix-neuf ans et son amant, Perez. Il les a trouvés ensemble. La ville est en émoi, la police, partout, patrouille. Quelqu’un dit que Rodrigo Paestra se cache sur les toits. On l’appelle, on le cherche, sans le trouver. L’orage éclate. Il force les touristes à attendre et à s’entasser dans l’Hotel Principal. Il force les policiers à attendre, tout en patrouillant, le lendemain. Au matin, l’orage aura cessé. La ville est encerclée. Il suffira de cueillir Rodrigo Paestra au matin.
Dans une petite ville d’Espagne où des touristes sont bloqués par l’orage, un meurtre a été commis. Maria, son mari Pierre, leur fille Judith, leur amie Claire sont parmi les touristes. Ils doivent se rendre à Madrid, mais l’orage les force à attendre le lendemain. Ils auront le temps, sans doute, autant en profiter, de s’arrêter pour voir trois Goya dans une église. Pierre y tient, Maria non. Maria boit beaucoup. C’est ainsi, toujours. Un meurtre a été commis. C’est Rodrigo Paestra qui a tué sa jeune femme de dix-neuf ans et son amant, Perez. Il les a trouvés ensemble. La ville est en émoi, la police, partout, patrouille. Quelqu’un dit que Rodrigo Paestra se cache sur les toits. On l’appelle, on le cherche, sans le trouver. L’orage éclate. Il force les touristes à attendre et à s’entasser dans l’Hotel Principal. Il force les policiers à attendre, tout en patrouillant, le lendemain. Au matin, l’orage aura cessé. La ville est encerclée. Il suffira de cueillir Rodrigo Paestra au matin.
A partir de cette situation, Marguerite Duras tisse un roman poétique, où les phrases et les personnages se répondent. Un roman d’appels, de découvertes, d’attente aussi. Le triangle du crime – Paestra, sa femme et l’amant – reproduit en négatif le triangle de l’attente constitué par Maria, Pierre et Claire. Pierre est indulgent envers l’alcoolisme de sa femme. Il est un être de patience, un être immobile ; son nom est celui de la matière contre laquelle Rodrigo Paestra se blottit sous l’orage. Paestra, le criminel, blotti sous une couverture brune aux allures de linceul, immobile contre la cheminée de pierre, n’entend pas Maria qui l’appelle. Elle l’a vu – par hasard ? D’entrée, Maria se sent portée vers cet homme ; appelée. Sortie sur un balcon de l’hôtel, elle est saisie par deux révélations : elle voit Paestra, que tout le monde cherche en vain, contre sa cheminée, la nuit, sous la pluie ; mais, illuminé par les éclairs, elle voit aussi Pierre, et Claire, dont les regards et les corps se rencontrent sur un autre balcon. Ils ignorent qu’ils sont vus ; eux non plus n’entendent pas le cri de Maria. Négatif, toujours : elle crie, en effet, vers Paestra qui ne l’entend pas, à cause de l’orage ; mais elle retient son cri devant ce qui se joue entre Pierre et Claire. Tout au long du roman, revient une question, la même, appliquée à différentes situations : « Est-ce fait ? » C’est dans cette tension vers ce qui doit s’accomplir que s’éploie le roman. A l’attente succède l’événement, pourtant l’atmosphère, avant et après cette nuit d’orage doublement révélatrice, reste pesante, comme le ciel chargé.
Une sorte de destin tient les personnages. C’est la connaissance supérieure de l’écrivain. Sur son toit, ainsi est décrit Rodrigo Paestra : « Sur la forme morte de Rodrigo Paestra, morte de douleur, morte d’amour, la pluie tombe de même que sur les champs. » Paestra mourra, en effet, dans un champ, alors même qu’il aura échappé à la police ; c’est que son sort est déjà scellé dès lors qu’il a tué. De même le sort de Maria, de Pierre et de Claire. L’amour de Pierre pour Maria a connu sa nuit sublime, désormais c’est dans l’attente d’une autre nuit semblable qu’il demeure immobile, avec Claire. Maria le sait, elle ne lutte pas. Lorsque Pierre revient vers elle, elle le repousse. Elle sait que le temps de leur amour est passé. Ce que raconte Dix heures et demie du soir en été, c’est « la fin d’une histoire ».
La première fois que les yeux bleus de Claire sont évoqués, on est surpris. C’est le temps d’une phrase, mais d’une phrase posée là, au milieu d’un paragraphe qui ne la concerne pas. Nous sommes avec Maria, dans un bar ; Pierre et Claire sont ailleurs, à l’hôtel. On ne les connaît pas encore. Cette phrase, surgie là, surprend. C’est le premier indice, peut-être, que deux histoires se jouent en même temps ; que celle de Rodrigo Paestra, centrale, n’est pourtant pas le véritable sujet du roman. Elle n’en est qu’une projection. On parlera de mise en abyme, si l’on veut, ou on n’en parlera pas. Plus tard, ces yeux reviennent. Ils ne sont pas bleus, d’ailleurs, ils sont gris. C’est le ciel chargé d’orage qui aura trompé Pierre, comme la phrase surgie nous aura surpris, nous. Tout se mêle. Découvrant Rodrigo Paestra mort, dans un champ de blé, Maria note : « Sur une pierre, le blé se fût recourbé de la sorte, pareillement. » Les amants tués étaient « dans les premiers temps de l’amour », comme Pierre et Claire. Et comme le furent Pierre et Maria lors d’une nuit à Vérone, il y a longtemps.
Le roman avance ainsi par échos. L’écriture est dense, surtout dans les premiers chapitres. La nature, le cadre et les personnages se répondent. Le vent qui balaie la ville, passe sur Rodrigo Paestra, passe aussi sous la jupe de Claire lorsqu’elle rencontre, secrètement, croit-elle, Pierre sur un balcon. Le regard est partout. Le même bois d’olivier s’étend devant les yeux de Maria qui feint le sommeil et derrière la fenêtre sous laquelle Pierre et Claire font, enfin, l’amour. Ce que nul ne voit, Maria, elle, le voit. Le même spectacle n’a cependant pas le même sens pour tous ; les moissonneurs ne comprennent pas ce que font ces touristes dans les champs de blé, où ils cherchent Rodrigo Paestra, que nul à part Maria n’y a encore vu. La pluie, la chaleur, le bleu – et toujours l’attente de ce qui doit arriver – « Est-ce fait ? » Bleu et gris sont les deux couleurs des yeux de Claire, celles du ciel, aussi, du ciel bas qui cache, du ciel dégagé qui met en pleine lumière.
Les personnages du roman apparaissent comme des marionnettes, acteurs d’une pièce déjà jouée dont on attend pourtant que son action s’accomplisse. De là cette épouvante, parfois, qui saisit les figures. Maria la ressent, Judith, qui pourtant assiste aux événements sans les comprendre, en apparence du moins. Epouvante devant le sentiment d’un drame inéluctable, auquel on est d’ores et déjà préparé, et soumis. Le sentiment d’amour passé qui commande à Maria de repousser Pierre, finalement, est associé à son sentiment d’une beauté fanée, qu’elle a accepté de flétrir, en s’abandonnant à son penchant pour l’alcool. « C’est aux mains sur son visage qu’elle le sent, qu’elle le sait, qu’elle fut belle mais qu’elle a commencé à l’être moins. C’est à la façon, sans aucun ménagement, dont elle passe les mains sur son visage, qu’elle sait qu’elle a accepté d’être défaite, à jamais. » La « solitude de l’alcool » est le destin auquel s’abandonne Maria (Marguerite ? C’est tentant, mais si facile !), après avoir cédé une dernière fois à l’appel du romanesque en aidant Rodrigo Paestra, l’assassin passionnel. Ainsi le sujet du roman n’est-il pas, ni l’histoire de Paestra, ni l’amour passé de Maria et Pierre – il est celui de l’entrée en solitude d’une femme qui est déjà spectatrice du monde qui l’entoure, y compris de sa propre vie.
Ce sentiment d’un destin déjà accompli, le mystère pourtant de l’attente, le consentement et comme l’indifférence déchirés pourtant par le chapitre III où Maria voit tout, dans la lumière furieuse des éclairs, sont mis en scène par la prose exacte, poétique de Marguerite Duras. Ses phrases ont un pouvoir d’attraction, de séduction intense, qui tient le lecteur captif.
Thierry LE PEUT


