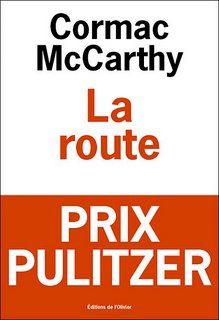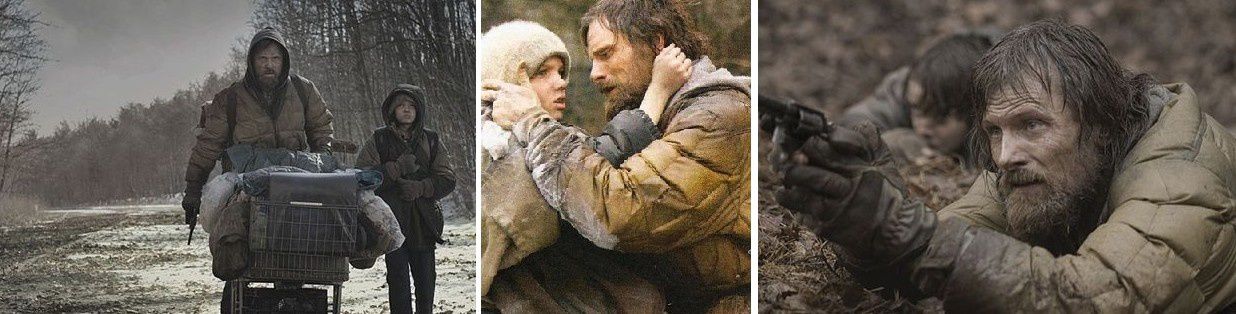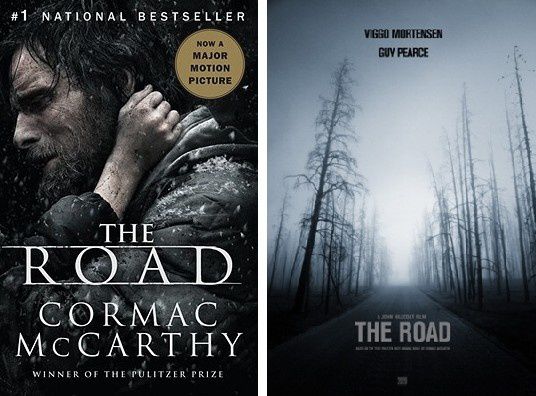Au programme ci-dessous :
Les maîtres-chanteurs ne tirent pas (1933)
L'indic (1934)
Un crime mariolle
La mort à roulettes
Du sang espagnol (1935)
Poissons rouges (1936)
Les maîtres-chanteurs ne tirent pas (1933)
Construction de la nouvelle :
Chapitre 1
Au Club Bolivar, Mallory rencontre l’actrice Rhonda Farr pour lui soutirer de l’argent en échange de lettres que lui écrivit jadis Landrey, devenues compromettantes parce que le bonhomme a viré gangster. Elle refuse de payer et laisse Mallory en compagnie de son garde du corps, Erno. Mais c’est Mallory qui a raison d’Erno.
Chapitre 2
Devant le Club Bolivar. Après le départ de Miss Farr, Mallory est pris à parti par deux types, un gros et un maigre, Mac Donald et Jim, flics semble-t-il, qui l’emmènent dans leur voiture. De toute évidence, ils sont en possession des lettres compromettantes et se demandent quel rôle vient jouer Mallory dans cette affaire. Curieusement, Mac Donald laisse à Mallory son Luger, placé sous son aisselle.
Chapitre 3
Une maison sur une colline au-dessus de Westward Village. Mac Donald et Jim amènent Mallory devant Costello et un rouquin, qui ont enlevé Rhonda Farr, retenue ailleurs. On apprend que Mallory a été engagé pour retrouver les lettres. Mac Donald se sert de lui pour se retourner contre la bande, qu’il cherchait un moyen de quitter. Il révèle à Mallory que le chef de Costello est Atkinson, l’avocat de Miss Farr.
Chapitre 4
Mallory, Mac Donald et Landrey – l’homme qui a engagé Mallory – se rendent chez Atkinson et l’emmènent. Il leur apprend où est retenue Rhonda Farr.
Chapitre 5
Sur le plateau, près de Baldwin Hills, la cabane de Slippy Morgan. La bande retrouve Rhonda Farr, droguée. Mac Donald et Slippy Morgan sont tués dans une fusillade. Mais les lettres ne sont toujours pas là ; Atkinson pense que c’est Costello qui les a.
Chapitre 6
L’immeuble où sont ligotés Costello, le rouquin et Jim. Mallory veut les lettres mais Costello essaie de le doubler en prenant une arme dans un coffre-fort où il prétend avoir placé les lettres. Apparition d’Erno ; Erno et Landrey s’entretuent. Mallory s’éclipse avant l’arrivée de la police.
Chapitre 7
Chez Rhonda Farr. Elle refuse de payer Mallory à la place de Landrey. Elle prétend avoir fait réaliser de fausses lettres et que toute l’histoire n’était qu’un coup publicitaire. Mallory, lui, lui apprend que les lettres en question, il les a retrouvées en fait dans la poche de Landrey après que celui-ci s’est fait descendre. Mallory part pour rencontrer les associés de Landrey.
Chapitre 8
Chez Mardonne, l’associé de Landrey. Mallory, venu tenter de se faire payer par Mardonne, raconte plusieurs versions de l’histoire, dans lesquelles c’est tantôt Rhonda tantôt Landrey qui tiraient les ficelles.
Chapitre 9
Chez Mardonne (suite). Mardonne veut se débarrasser de Mallory, sans doute pour tenter de tirer profit lui-même de l’affaire, en faisant chanter Miss Farr. Mais la fusillade laisse Mardonne sur le carreau tandis que Mallory s’en tire blessé mais vivant.
Chapitre 10
Bureau de l’inspecteur-chef Cathcart. Celui-ci présente à Mallory la version officielle des événements de la nuit passée : règlements de comptes divers, la réputation de Mac Donald ne sera pas éclaboussée, Mallory ne sera pas inquiété. Plutôt que de retourner à Chicago où il a sa petite agence, Mallory a décidé de rester dans le coin.
Commentaire :
Si l’une des caractéristiques du « noir » est la confusion de ses intrigues, cette nouvelle est un modèle du genre. Les chapitres découpent l’action en tableaux très compartimentés (un lieu différent à chaque fois, sauf pour le dénouement réparti sur les chapitres 8 et 9), chacun contribuant à lever le voile sur la teneur réelle de l’intrigue. Fausses pistes, policiers agissant comme des truands, truands finissant en victimes, maître-chanteur se révélant détective, avocat se révélant maître-chanteur… tout cela tournant autour d’une victime antipathique qui joue elle-même avec la vérité et se concluant par un rapport de police qui construit également une vérité factice pour lier les événements en un tout à peu près cohérent qui n’éclaboussera pas la police. La plupart des personnages agissent par intérêt et certains jouent double jeu, l’intrigue respecte la loi du mouvement perpétuel qui ne s’arrête qu’après plusieurs morts et lorsque la vérité est à peu près claire.
Le héros lui-même est ambigu puisqu’il se présente d’abord sous les traits d’un maître-chanteur avant de se révéler détective privé engagé pour mettre fin au chantage. De manière classique, il est utilisé par son employeur, et d’ailleurs par la plupart des personnages qu’il croise : son cheminement consiste donc à découvrir la vérité qu’on lui a cachée – voire, ici, les vérités, chacun ayant finalement sa propre version des événements.
La tonalité d’ensemble penche clairement vers le cynisme, chacun essayant de tirer avantage d’une situation dont il ne maîtrise que certains éléments, même lorsqu’on le croit à l’origine de tout. L’arrière-plan – Hollywood – est esquissé comme un microcosme implacable fonctionnant selon ses propres règles et où chacun – actrice, avocat – joue double jeu pour servir ses intérêts égoïstes, avec une absence de compassion remarquable. Le chapitre final démontre que la police n’a pas davantage pour fonction de démêler le faux du vrai, ses conclusions étant elles aussi assujetties à des considérations égoïstes. Au milieu de tout cela se trouve donc le privé, le seul dont la mission est de découvrir la vérité.
La nouvelle présente une belle galerie de « gueules ». Le couple de flics ripoux, le gros Mac Donald et le petit aux cheveux gris, Jim ; le garde du corps Erno, du genre efféminé, à la manière du Joel Cairo du Faucon maltais ; le gangster Landrey, figure silencieuse à la « gangster de cinéma », jusqu’à ce qu’il se fasse plomber ; Atkinson, l’avocat véreux, et Mardonne, l’associé opportuniste et gourmand ; Rhonda Farr, la star de Hollywood, avec fume-cigarettes et grands airs, à son aise dans un monde où tout est factice. Et au milieu, le détective, seule figure honnête, mais aussi l’inspecteur-chef Cathcart, qui intervient pour mettre de l’ordre après que le détective a fait le boulot.
L’indic (1934)
La première enquête de Philip Marlowe ne se distingue pas des autres histoires de privé de Raymond Chandler (et pour cause : le nom de Marlowe remplaça celui originellement utilisé par Chandler : Carmody). Sinon par le lieu : nous ne sommes pas à Los Angeles mais à San Angelo – bien que le nom du District Attorney, Horney, soit le même que dans « Un crime mariolle », qui se déroule à L.A. Le privé se distingue de la police officielle en étant le seul à pouvoir conduire à la mise en accusation d’un mafieux local (c’est le postulat du premier chapitre) – mais la corruption l’emporte quand même, puisque la mise en accusation est rejetée par le tribunal, ce qui met le courageux maverick en danger de mort. Il peut malgré tout compter sur les gens honnêtes que comptent les forces de l’ordre, en l’occurrence le lieutenant du commissaire de district.
L’ambiance est donnée dans les premières pages. Celle du personnage : « J’avais passé l’âge de m’amuser à gueuler après les gens que je ne peux pas atteindre. » Celle du bureau du privé : « Je me détournai et promenai mon regard autour de la pièce. Elle avait un tapis rouille, cinq classeurs verts alignés sous le calendrier réclame, un vieux portemanteau dans un coin, quelques chaises en noyer, des rideaux de filet aux fenêtres. La frange était sale à force de balayer la poussière au gré des courants d’air. Un rayon de soleil attardé tombait sur mon bureau et mettait la saleté en valeur. »
Le détective dispose d’acolytes de qualité : outre le lieutenant déjà cité, un chauffeur de taxi père de famille qui prend le fusil contre les mafieux qui menacent son petit monde, et un journaliste qui reste dans l’ombre mais qui rappelle que les journalistes sont aussi des auxiliaires de la vérité dans l’univers de Chandler (et plus largement dans le genre où il officie).
Le moteur de l’action, c’est bien sûr la menace de mort qui pèse sur le privé à cause de son implication dans un procès ; mais c’est aussi la mort d’un ami, sacrifié à ce désir de revanche des mafieux. Chapeautant les gangsters, un politicien : « un ponte de la politique, un gars qu’il faut aller voir quand on veut ouvrir un tripot ou un bordel ou vendre de l’honnête marchandise à la ville ». Ne pas oublier, pour parachever la distribution, une jolie rousse jouant double jeu.
La petite remarque finale est appelée à une postérité remarquable : elle concerne les honoraires du privé, « deux cents dollars plus les frais », qui donnera son titre (français) à une célèbre série américaine des années 1970 (en v.o. The Rockford Files) et servira de nouveau dans Magnum.
Un crime mariolle
Le privé est John Dalmas, dont c’est peut-être la première enquête. Le récit est à la troisième personne, comme c’était le cas dans « Les maîtres-chanteurs ne tirent pas » et comme ce sera le cas dans les enquêtes suivantes de Dalmas, « Un tueur sous la pluie » et « Déniche la fille ». « Un crime mariolle » s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de « Les maîtres-chanteurs ne tirent pas », par le lieu (Los Angeles), par la présence du même chef de la police (l’Irlandais Cathcart), par la référence à la société de production « Eclipse » qui engage Mallory à la fin de « Les maîtres-chanteurs… » et pour laquelle travaille Dalmas au début de « Un crime mariolle ». La structure du récit est grossièrement la même : début in medias res, enchaînement serré d’actions, dénouement avec exposé des faits démêlés, conclusion dans le bureau de l’inspecteur-chef Cathcart. L’action est toutefois moins complexe que dans « Les maîtres-chanteurs… ». Le privé travaille en marge de la police mais ses rapports avec elle ne sont pas spécialement agressifs : Weinkassel ne l’impressionne pas, Lonergan n’aime pas les privés et le dit, Cathcart le trouve plutôt sympathique et boit un verre avec lui à la fin de l’aventure ; Dalmas a un ami dans la place, dont le nom n’est pas cité : « C’est un flic cent pour cent, mais c’est un vieux de la vieille et il se fout pas mal de sa publicité. » Ce pourrait être Violets M’Gee, que l’on rencontrera plus tard dans « Un tueur sous la pluie » et « Bay City Blues » (simple hypothèse).
Construction de la nouvelle :
Chapitre 1
Chez Derek Walden. Dalmas vient lui annoncer qu’il ne veut plus travailler pour lui ; il a remarqué qu’on le suivait mais Walden prétend n’avoir engagé personne. Deux truands, Noddy et Ricchio, débarquent et font chanter Walden, emmenant Dalmas comme garantie. Il leur échappe grâce à l’intervention de son ami chauffeur de taxi, Joey.
Chapitre 2
Dans son appartement du Merivale, Dalmas reçoit un coup de fil de Mianne Crayle, qui s’inquiète du silence de Walden. Elle l’envoie chez lui, où il le trouve mort : meurtre maquillé en suicide. Le numéro de série du revolver est limé à l’extérieur mais Dalmas le trouve à l’intérieur de l’arme, qu’il démonte et remonte avant de s’en aller, sans appeler la police.
Chapitre 3
Dalmas va trouver Miss Crayle à une réception chez John Sutro, conseiller municipal. Elle admet avoir trouvé Walden mort avant d’appeler le privé.
Chapitre 4
Au Carli’s, Mianne Crayle conte les faits à Dalmas. Elle se sait suspecte mais prétend ne pas avoir tué Walden. Elle révèle 1) qu’il faisait du trafic d’alcool, 2) qu’il était gaucher ; or, l’arme a été placée dans sa main droite. Dalmas lui propose d’aller conter son histoire à un ami policier qui saura tenir sa langue quelques heures.
Chapitre 5
Dans son appartement du Merivale, Dalmas met au parfum un enquêteur d’Eclipse, Denny. Il veut tirer l’affaire au clair avant que la police ne découvre le cadavre de Walden. Il compte suivre la piste de l’arme.
Chapitre 6
Dalmas rend visite à Helen Dalton, à qui appartenait le revolver, qui a servi déjà à tuer un journaliste, mari de la fille. Celle-ci est l’amie de John Sutro. Elle prétend avoir laissé le revolver à un prêteur sur gage il y a longtemps déjà. En la quittant, Dalmas retrouve Joey ; des coups de feu éclatent, Joey est blessé, les tireurs prennent la fuite dans un coupé Cadillac.
Chapitre 7
Dans le bureau des Lts Weinkassel et Lonergan. Dalmas garde le silence ; Weinkassel lui donne jusqu’au lendemain pour continuer ses investigations avant de revenir déballer son histoire. Sitôt sorti, il reçoit un appel de Denny qui lui demande de le rejoindre chez lui, où il a emmené Helen Dalton.
Chapitre 8
Chez Denny, une villa dans les collines. Dalmas a compris que Denny le surveillait depuis un moment (voir chapitre 1) et l’a attiré dans un traquenard. Deux types un uniformes de flics arrosent la maison ; Denny, blessé à la main, révèle à Dalmas le nom de son employeur, John Sutro.
Chapitre 9
Le club de Donner. Dans le bureau de ce dernier, Dalmas retrouve Sutro, Noddy et Ricchio. Celui-ci a été travaillé par les hommes de main de Donner : c’est Ricchio qui faisait chanter Walden, et qui a tiré sur Joey. Il roulait pour son propre compte. D’abord complice de Walden (dont il était le garde du corps) dans le trafic d’alcool, il y a ajouté le trafic de drogue ; Walden, l’ayant découvert, l’a viré et Ricchio l’a fait chanter. Mais Dalmas révèle que Ricchio n’a pas tué Walden : c’est Sutro le coupable. Une fusillade s’ensuit, au cours de laquelle Donner est blessé. Puis Dalmas téléphone à l’inspecteur-chef Cathcart.
Chapitre 10
Bureau de Cathcart, qui fait le bilan de l’affaire avec Dalmas. Sutro a été tué par sa femme alors que la police venait de l’arrêter. Crime passionnel. Joey n’est pas grièvement blessé. Les « artilleurs » qui ont arrosé la maison de Denny travaillaient pour Sutro, on ne les a pas arrêtés.
La mort à roulettes
« La mort à roulettes » n’est pas une histoire de détective. C’est plutôt une histoire de truands, si l’on croit sur parole l’un des personnages lorsqu’il présente le héros, Johnny De Ruse, un « gangster ». Quant à ce que recouvre exactement ce qualificatif, c’est assez difficile à dire puisque celui qui l’emploie se révèle être l’artisan du mauvais coup qui fournit le matériau de l’histoire, tandis que le gangster en question est le héros qui démêle les fils et décide finalement de se ranger des voitures en épousant la fille qu’il avait congédiée quelques chapitres plus tôt. Quant au privé, il n’est pas absent de l’aventure mais y joue l’auxiliaire, la seconde main, ce qui concourt d’ailleurs à faire passer le « gangster » du « bon » côté de la morale.
De Ruse est donc un « gangster » flanqué d’une fille qui cherche le confort dans ses bras mais la tendresse dans ceux d’un autre. Non parce que De Ruse manque de tendresse : au contraire, c’est plutôt un tendre, pas un « mou » comme elle le lui jette à la figure dans un moment de dépit, mais un cœur tendre, un homme à principes qui a jadis rencardé les flics et permis l’arrestation d’un kidnappeur, genre de gogo que De Ruse ne prise pas. Justement, c’est le retour en ville du gogo qui lance l’histoire. Désireux de se venger, il tente de faire son affaire à De Ruse en le faisant enlever, ce qui pousse De Ruse à remonter jusqu’au cerveau pour mettre bon ordre dans son entourage. Accessoirement en faisant exploser ledit cerveau.
« La mort à roulettes » sonne quasiment comme une petite fable morale. La victime des truands est un politicard roublard au cadavre duquel son ravisseur finira par passer une nuit ligoté. Le « gangster », lui, qui se préparait à prendre la poudre d’escampette pour éviter les embrouilles, est forcé de faire le ménage pour éviter d’être accusé de complicité, vu qu’il a refroidi les deux kidnappeurs qui avaient enlevé le politicien avant de l’embarquer dans la même voiture, une limousine trafiquée de manière à faire de son compartiment arrière une petite chambre à gaz sur roues. La « fille » du gangster, pas franchement amoureuse mais punie de ses infidélités par la mort du bellâtre qui s’est allié aux truands pour améliorer ses vieux jours, se révèle moins pourrie qu’on ne le croirait en apportant un coup de griffes bienvenu à De Ruse, qui finit par la demander en mariage. D’où la fin « morale », qui promet une récompense aux gentils après avoir scellé le sort des méchants. Après tout, à voir la manière dont elle caresse le front de son homme dans le dernier chapitre, il n’est pas impossible que la « fille » soit quand même un peu amoureuse…
Les personnages de la nouvelle payent le tribut aux clichés habituels mais l’un d’eux se détache par son côté bigger than life qui tient autant à sa part de cliché qu’aux ajouts personnels qu’y fait Chandler. Un « ancien de la boîte à flics de Walls Fargo » affublé du patronyme de Kuvalick et d’une moumoute qui cache la misère du sommet de son crâne, tandis que lui-même cache un feu de la taille d’un fusil de chasse et un gilet pare-balles qui permet de lui faire jouer les deus ex machina après l’avoir proprement envoyé au tapis. « Je ne suis pas une mauviette ! Je suis de l’école de Wells Fargo ! » Ce n’est pas forcément en faisant dans la dentelle qu’on surprend son lecteur.
Du sang espagnol (Spanish Blood, Novembre 1935, Black Mask)
« Du sang espagnol », c’est ce qui coule dans les veines de Sam Delaguerra, inspecteur à la Brigade criminelle. Traduisez : c’est un dur, quelqu’un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C’est pourquoi il continue d’enquêter sur la mort de son ami, le politicien Donegan Marr, même lorsque ses chefs le retirent de l’enquête au prétexte qu’il connaissait trop bien la victime, dont d’ailleurs il aimait l’épouse, avant même qu’elle ne devienne Mme Belle Marr.
Le héros de Chandler est donc cette fois un policier, tout ce qu’il y a d’officiel. Mais un maverick quand même, puisque non seulement il agit contre les instructions de sa hiérarchie mais en outre il est victime de coups montés destinés à le pousser sur le bas-côté. « Du sang espagnol » navigue en pleines eaux politiciennes, entre belle maison citadine et petite cabane au bord du lac, politicards véreux et flicards corrompus. Le dénouement se déroule dans un bain de sang, dont celui, espagnol, du flic héroïque. En chemin, plusieurs cadavres ont jalonné l’intrigue. Au terme de l’aventure, la vérité officielle diffère quelque peu de la vérité tout court, révélée dans l’ultime chapitre, et le héros se prête au jeu : il est vain de croire au grand nettoyage – sinon par le vide, comme le font les coupables avant de s’effacer eux-mêmes -, et la fidélité aux morts justifie certains aménagements. A défaut d’imposer la « vraie » vérité, le héros se montre ainsi loyal envers les dernières volontés d’un ami.
« Du sang espagnol » déroule ainsi une intrigue calibrée et sans surprise, épousant la structure habituelle des nouvelles publiées dans Black Mask : une suite de chapitres courts caractérisés chacun par l’unité de lieu, d’action et en général de temps, un dénouement placé dans l’avant-dernier chapitre et un chapitre ultime pour liquider les dernières scories du récit. La touche finale, c’est un peu le poor lonesome cow-boy d’un Lucky Luke, avec soleil couchant dans le ton sinon dans l’image. Côté personnages, la faune de la nouvelle est classique également : la corruption gangrène les hautes sphères – politiciens et chef de la police –, secrets et turpitudes se terrent dans les maisons, mais il reste quelques « petits » pour sauver l’ensemble en restant fidèles à des principes d’amitié, de loyauté, d’honnêteté. Dans la mesure de leurs moyens. C’est le cas bien sûr du héros, mais aussi de son compère policier, Pete Marcus, qui a cessé de se prendre le chou pour de hautes idées mais qui reste prêt à foncer dans le tas pour imposer un peu de décence et prendre la défense de son partenaire.
Poissons rouges (Goldfish, Juin 1936, Black Mask)
Au début du chapitre 2, on croit tenir le nom du privé qui s’exprime ici à la première personne : étant donné qu’il a aidé un policier du nom de Benie Obis à alpaguer un truand du nom de Peter Andrews du côté de Grey Lake, ce ne peut être que Philip Marlowe, qui dans « L’indic » aidait le flic Bennie Ohls à mettre le grappin sur le truand Poke Andrews du côté de Grey Lake. Eh bien non : le chapitre 3 nous donne le nom du privé, il s’agit de Carmady, le narrateur-héros de « Déniche la fille ». Si Marlowe officiait à San Angelo, Carmady est un privé de L.A. Quant à savoir où est Grey Lake, dans tout cela…
« Poissons rouges », de toute façon, finit par éloigner le privé de son décor habituel pour l’envoyer dans le Nord, du côté du Canada, où se tient le dénouement de l’histoire. Chandler l’écrivait lui-même : ce qui compte, dans toutes ces nouvelles conçues pour plaire à Black Mask, c’est le dénouement, le reste n’étant que prétexte à de bonnes scènes. Les bonnes scènes mettent ici en présence Carmady, un vieil homme répondant au nom de Sunset et bientôt rattrapé par le coucher de soleil, un couple composé d’un avoué bedonnant et de sa moitié, celle qui porte la culotte, une ancienne femme flic qui attend que son homme sorte de San Quentin pour pouvoir essayer encore de le remettre sur le droit chemin, et quelques autres. Seuls quelques-uns de ces gusses arrivent jusqu’au dénouement, évidemment le morceau de choix de la nouvelle, qui ne fait pas mentir Chandler. Là, un autre couple vient garnir la galerie de personnages, un autre tandem parvenu à l’automne de la vie, sinon à l’hiver.
Ce qui fait bouger tout ce monde, ce sont les deux cent mille dollars de perles Leander que Wally Sype a volées des années plus tôt et qu’il cache encore quelque part. Mis sur leur piste, le détective doit composer avec la concurrence, et compter sur le talent du romancier pour le débarrasser de celle-ci. Au final, il reste avec les perles en poche, une prime à partager finalement en deux, et une gentille petite bonne femme dont le visage se décompose brusquement pour livrer passage à un crachat ultime. Vous lirez pour comprendre. Mais ce visage est l’une des images fortes de « Poissons rouges », où l’on n’a pas besoin d’être trop aiguillé pour comprendre que les poissons détiennent la clé de l’énigme. Les Chinois, précisément. Autres images fortes : celle de la même petite bonne femme faisant exploser le dos d’une autre bourgeoise avec un gros Colt qu’elle tient des deux mains, celle d’un petit vieux aux pieds brûlés étendu en croix sur son dernier lit, ou d’un couple de vieux parlant un drôle de langage là-bas, dans le Nord.
Thierry LE PEUT
 La Réserve commence comme un roman à l’eau de rose, évoquant les mélodrames sur fond d’Histoire de Judith Krantz ou Barbara Taylor Bradford : la chose étonne, mais correspond bien à l’illustration de couverture (la même en France que dans l’édition originale). Un décor magnifique, ouverture sur les sommets enneigés qui bordent un Grand Lac des Adirondacks, au bord duquel se tient une élégante silhouette hollywoodienne dont le rouge répond à celui d’un hydravion arrivant par le ciel. Garbo ? En tout cas le cadre évoque ces drames flamboyants et surannés que produisait le cinéma des années 1930, sur fond de dépression : précisément le cadre historique que choisit Russell Banks pour son histoire. C’est dans le courant du premier chapitre, mais surtout au-delà, que l’écrivain donne quelques coups de couteau à cette image glamour, pour en révéler les mensonges eten écorcher la patine.
La Réserve commence comme un roman à l’eau de rose, évoquant les mélodrames sur fond d’Histoire de Judith Krantz ou Barbara Taylor Bradford : la chose étonne, mais correspond bien à l’illustration de couverture (la même en France que dans l’édition originale). Un décor magnifique, ouverture sur les sommets enneigés qui bordent un Grand Lac des Adirondacks, au bord duquel se tient une élégante silhouette hollywoodienne dont le rouge répond à celui d’un hydravion arrivant par le ciel. Garbo ? En tout cas le cadre évoque ces drames flamboyants et surannés que produisait le cinéma des années 1930, sur fond de dépression : précisément le cadre historique que choisit Russell Banks pour son histoire. C’est dans le courant du premier chapitre, mais surtout au-delà, que l’écrivain donne quelques coups de couteau à cette image glamour, pour en révéler les mensonges eten écorcher la patine. 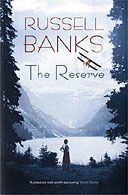 Une fois commencé, le roman se laisse difficilement interrompre et la certitude d’un dénouement tragique n’empêche pas le récit d’être souvent surprenant et toujours fascinant. Les vérités que l’on croit toucher se refusent aux certitudes, les personnages semblent se révolter contre le destin qu’on leur imagine, sans que l’on puisse dire qu’ils se rendent finalement maîtres de leur vie. Les choses arrivent, souvent irréfléchies, irréversibles, auxquelles chacun réagit avec sa conscience, étonné soi-même de son propre cheminement. Les personnages se placent eux-mêmes dans les situations qu’ils sentent, qu’ils savent pourtant, obstinément, devoir éviter : on les suit jusqu’à cet instant fatal où ils passent le point de non retour. Comme si l’ombre spectrale de la Guerre, cet avenir déjà-là, recouvrait de sa présence glacée, glaçante, le libre-arbitre des personnages. A l’image de ces glaciers que la montagne abandonne à l’océan, à la fin du roman, et que recouvre brusquement l’ombre du gigantesque Hindenburg.
Une fois commencé, le roman se laisse difficilement interrompre et la certitude d’un dénouement tragique n’empêche pas le récit d’être souvent surprenant et toujours fascinant. Les vérités que l’on croit toucher se refusent aux certitudes, les personnages semblent se révolter contre le destin qu’on leur imagine, sans que l’on puisse dire qu’ils se rendent finalement maîtres de leur vie. Les choses arrivent, souvent irréfléchies, irréversibles, auxquelles chacun réagit avec sa conscience, étonné soi-même de son propre cheminement. Les personnages se placent eux-mêmes dans les situations qu’ils sentent, qu’ils savent pourtant, obstinément, devoir éviter : on les suit jusqu’à cet instant fatal où ils passent le point de non retour. Comme si l’ombre spectrale de la Guerre, cet avenir déjà-là, recouvrait de sa présence glacée, glaçante, le libre-arbitre des personnages. A l’image de ces glaciers que la montagne abandonne à l’océan, à la fin du roman, et que recouvre brusquement l’ombre du gigantesque Hindenburg. 


 « Une histoire qu'il revient à moi seul de conter. Peut-être n'en suis-je pas le detrnier témoin encore en vie, peut-être se trouve-t-il d'autres personnes dans cette bourgade du Montana qui se souviennent de ces événements aussi bien que moi. Nul toutefois ne peut prétendre avoir connu ces trois êtres mieux que moi.
« Une histoire qu'il revient à moi seul de conter. Peut-être n'en suis-je pas le detrnier témoin encore en vie, peut-être se trouve-t-il d'autres personnes dans cette bourgade du Montana qui se souviennent de ces événements aussi bien que moi. Nul toutefois ne peut prétendre avoir connu ces trois êtres mieux que moi. Le narrateur choisit de conter ce qu'il a vu, entendu, su et ressenti à l'époque de ses douze ans, faisant du roman un récit de passage à l'âge adulte, par la révélation des turpitudes cachées derrière les apparences respectables. C'est à travers les yeux de l'enfant que l'on appréhende les protagonistes du drame, à commencer par les parents, et surtout le père. Infirme, déconsidéré par son propre père au profit du frère « parfait » et héros de guerre, le shérif est un homme dont la force de caractère va se révéler à la faveur d'une enquête dont il cherche d'abord à esquiver la nécessité. Conscient de la difficulté à mener à terme l'instruction d'une affaire aussi scabreuse, dont les victimes ne sont « que » des Indiennes, mais paralysé surtout à l'idée d'affronter à la fois son frère et son père, le shérif trouve refuge dans le déni ; mais, une fois convaincu que son devoir est de porter au jour les événements désormais avérés, il ne lui est plus possible de fermer les yeux, de choisir le compromis, de céder devant l'intimidation.
Le narrateur choisit de conter ce qu'il a vu, entendu, su et ressenti à l'époque de ses douze ans, faisant du roman un récit de passage à l'âge adulte, par la révélation des turpitudes cachées derrière les apparences respectables. C'est à travers les yeux de l'enfant que l'on appréhende les protagonistes du drame, à commencer par les parents, et surtout le père. Infirme, déconsidéré par son propre père au profit du frère « parfait » et héros de guerre, le shérif est un homme dont la force de caractère va se révéler à la faveur d'une enquête dont il cherche d'abord à esquiver la nécessité. Conscient de la difficulté à mener à terme l'instruction d'une affaire aussi scabreuse, dont les victimes ne sont « que » des Indiennes, mais paralysé surtout à l'idée d'affronter à la fois son frère et son père, le shérif trouve refuge dans le déni ; mais, une fois convaincu que son devoir est de porter au jour les événements désormais avérés, il ne lui est plus possible de fermer les yeux, de choisir le compromis, de céder devant l'intimidation.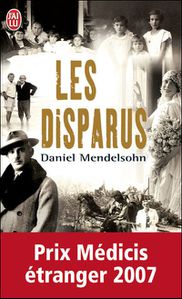 La première exergue de Les Disparus
La première exergue de Les Disparus  Un tueur sous la pluie (Killer in the Rain, Janvier 1935, Black Mask)
Un tueur sous la pluie (Killer in the Rain, Janvier 1935, Black Mask)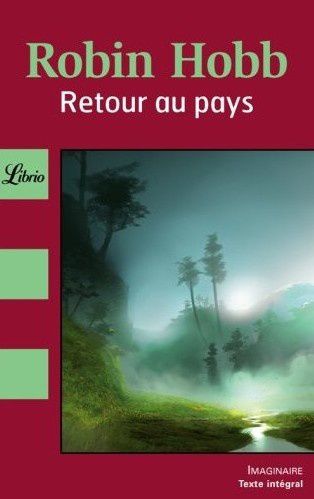 Il est impossible en lisant Retour au pays de ne pas avoir constamment à l’esprit les récits de Lovecraft évoquant d’anciennes cités aux pouvoirs envoûtants et terrifiants. Car c’est là le cœur de ce récit de fantasy où Robin Hobb mêle exploration et discours sur l’art, confondu avec la magie.
Il est impossible en lisant Retour au pays de ne pas avoir constamment à l’esprit les récits de Lovecraft évoquant d’anciennes cités aux pouvoirs envoûtants et terrifiants. Car c’est là le cœur de ce récit de fantasy où Robin Hobb mêle exploration et discours sur l’art, confondu avec la magie. Sous-titré Un polar postmoderne, ce petit opus de David Grann - publié en petit format chez Allia - propose une histoire criminelle restituée avec la minutie d'un article de journal. Grann est d'ailleurs journaliste au New Yorker. Tout commence par le compte rendu du crime, jusqu'au classement de l'affaire, faute d'éléments suffisants pour désigner un coupable. Le crime, c'est le meurtre d'un homme, un homme apparemment sans histoire, et sans ennemi. Mais ce classement n'est que le début de l'investigation relatée par David Grann : des années plus tard, un inspecteur de police réouvre le dossier, relance l'enquête... et tombe sur une piste prometteuse.
Sous-titré Un polar postmoderne, ce petit opus de David Grann - publié en petit format chez Allia - propose une histoire criminelle restituée avec la minutie d'un article de journal. Grann est d'ailleurs journaliste au New Yorker. Tout commence par le compte rendu du crime, jusqu'au classement de l'affaire, faute d'éléments suffisants pour désigner un coupable. Le crime, c'est le meurtre d'un homme, un homme apparemment sans histoire, et sans ennemi. Mais ce classement n'est que le début de l'investigation relatée par David Grann : des années plus tard, un inspecteur de police réouvre le dossier, relance l'enquête... et tombe sur une piste prometteuse. Lorsque l'on évoque "les risques du métier", c'est au
Lorsque l'on évoque "les risques du métier", c'est au