LA PART MANQUANTE de Christian Bobin
Gallimard, 1989 – Folio, 1994 (n° 2554)
Les citations sont extraites de l’édition Folio
Il parle d'enfance, d'âme et de solitude

On ne rend peut-être pas compte d’un livre de Christian Bobin. On le lit, c’est tout. J’en ai extrait ici quelques phrases, des pensées, des images, qui touchent forcément à la subjectivité, la mienne. Ce ne sont pas celles qu’un autre aurait retenues, parce qu’elles parlent à ce que je suis, qu’elles font écho à mes lectures et à ce que mes lectures font résonner en moi. D’autres pensées, d’autres images, qui ne m’appartiennent pas et que je crois reconnaître dans les mots de Bobin. C’est cela, un écrivain : un esprit qui pense, qui pense sans se soucier de vous, qui pense comme vous pourtant, ce pourquoi on se reconnaît en eux, on s’identifie à eux parfois, puis on les quitte, pour s’écouter toujours davantage en écoutant un autre, encore un autre.
Se contenter de ces extraits n’a pas de sens. Il faut les replacer dans leur contexte, lire le texte entier. Certaines citations, soustraites à ce contexte, ont un sens autre que celui que (peut-être) Bobin leur donne. Elles deviennent miennes, pas forcément vôtres. C’est aussi pourquoi je n’ai pas hésité, parfois, à citer des lignes entières, plutôt qu’une seule phrase ; de toute façon il faut que toi-même tu les lises, que toi-même tu suives le fil de la pensée de Bobin, pas le mien. Parfois, il est difficile de savoir où commencer, où s’arrêter ; parfois j’ai outrepassé les extraits que j’avais retenus à la lecture, parce qu’il fallait aller plus loin, ne pas couper le flux ; et parfois j’ai tranché. A tes risques et périls.
La part manquante est constituée d’une suite de textes qui ne sont pas étrangers les uns aux autres. Tu le verras dans les citations, certaines se répondent, d’un lieu à l’autre du livre. Mais elles sont aussi les échos des autres livres de Bobin, qu’il faudra lire – que je lirai, moi aussi, peut-être, en revenant à Bobin. Quand il m’a semblé que certaines étaient trop liées à leur objet, à leur sujet, pour les en séparer, j’ai indiqué le titre du texte qui les enveloppe. Pour les autres, je les ai laissées affranchies de leur titre, pour les laisser dans une indifférenciation universelle, ou peut-être essentielle. « Allez savoir. »
Ce faisant, au fond, j’ai respecté, je crois, la nature des livres de Bobin. Ce sont des pensées qui peuvent se lire n’importe quand ; on prend un Bobin entre deux lectures. Puis on le repose, pour y revenir, et pour le prolonger plus tard par un autre. On le feuillette, en s’appuyant sur les passages qu’on a marqués plus tôt ; un jour on le relira, et on y marquera sans doute d’autres passages. Ce sont les haltes de la pensée, les instants où le sentiment se reconnaît. Ce sont ces instants d’une lecture, qui ne sont pas ceux d’une autre, que j’ai voulu conserver ici. Pour moi autant que pour toi. Un témoignage d’un moment de ma vie autant que les vestiges d’une lecture.
Ces pensées d’un jour dépassent le cadre du jour, comme celui du livre, comme celui du titre après lequel elles sont rangées dans le livre. On peut d’ailleurs lire ces titres dans le désordre, sans égard pour le travail de l’écrivain qui, peut-être, les a rangés dans un ordre voulu, signifiant. Je crois avoir lu la fin, puis être remonté jusqu’au milieu, avant de reprendre au début, jusqu’au milieu. C’est un choix comme un autre, qu’autorise Bobin, et dont s’insurgerait un autre livre.
On parle ici de neige, d’âme, d’enfance beaucoup, et de lecture. Tout est lié d’ailleurs. Tout touche à l’âme, la blancheur de la page, celle de la neige, le pas de l’ange, la voix, le souffle, les images et les mots que l’écrivain emploie. C’est ce jeu d’échos, de flux et de reflux, de retours qui compose la lecture. J’ai dit tout à l’heure qu’on lisait un Bobin entre deux lectures. Cela ne veut pas dire qu’on le lit en tranches, comme on déguste une clémentine – d’ailleurs, laisseriez-vous traîner votre clémentine avant d’y revenir ? Le Bobin se lit d’une traite, même si c’est dans le désordre. C’est pour cela qu’il a la délicatesse, l’écrivain, de nous offrir des livres courts et déjà découpés en quartiers, pour faciliter notre dégustation. C’est en s’offrant le temps de cette dégustation, un quartier après l’autre mais le livre tout entier, qu’on se laisse pénétrer par les mots, les pensées et les images, et ce jeu de l’écriture, devenu jeu de lecture, est la voix et le mouvement qui parle à l’âme. Rien de mystique aussi – ou si peu. A moins que tout acte de lecture (ne) soit mystique. Lecteur, tu es juge.
Les citations que j’ai retenues sont peut-être celles qui touchent le plus à cet acte : écriture, lecture. Pour moi ce ne sont pas deux, mais un. Ils se touchent et se répondent plus qu’ils ne se complètent (même si je reconnais la grande part de sophisme de l’expression – mieux vaut en rire !). Ce sont celles aussi qui touchent à l’enfance, car il me semble que tout, pas seulement l’écriture, pas seulement la lecture, que tout y ramène. A cette idée exprimée par Bobin que toutes nos attitudes proviennent de l’enfance ; c’est là qu’elles se cristallisent, qu’elles naissent en dehors de la conscience (de la nôtre, de celle qui nous voient grandir peut-être aussi, dans l’amour, la crainte et le secret qui toujours et déjà conditionnent ce que nous serons une fois conscients). De sorte que, parvenu à l’âge adulte, on n’en finit pas de redécouvrir ce territoire où sont tapis les démons, ou ils s’égaillent, dans un grand rire, car les démons ne sont pas tous malins. Et l’on rêve de retourner dans ce pays (Peter Pan, tu n’es jamais loin, ah ! M. Barrie !), maintenant pourvu de la conscience, et de retrouver les sensations qu’on y a éprouvées avant de les comprendre. Plus qu’une nostalgie, une construction de soi, une découverte. La vie se découpe en actes ; celui des émotions premières précède celui de la conscience, qui cherche à retrouver la pureté perdue. Le serpent se mord la queue – certains en font un drame, d’autres une tragédie, d’autres préfèrent en rire d’un rire qui n’est peut-être pas si franc, un cousin de la peur, ou son ombre peut-être.
De Bobin je n’ai pas d’idée informée. Au fond je ne le connaissais pas avant de le voir sur un écran, et de l’entendre. Sa parole est celle d’un poète, il est un invité qui n’appartient pas au lieu ni au moment, dont les mots font toucher un monde intérieur qui continue de s’épancher dans les livres. C’est ce monde intérieur qui est attirant. Parce qu’il semble réaliser ce dont rêvent ceux qui le lisent : une vie de lecture, d’écriture et de rapport direct au monde, aux choses comme aux sensations, aux émotions qu’elles suscitent et à l’écoute desquelles se met l’écrivain. Lisant Bobin, on retrouve une révolte naïve, celle dont il parle dans La part manquante, la révolte face au temps contraint, au travail qui est perte de soi, di-gression insupportable si l’on suit trop la « pente » Bobine. Le livre permet de s’avouer cette perte, de se retrouver le temps d’une lecture. A chacun ensuite de choisir le retour qu’il veut, ou qu’il peut : ici, ou là-bas.
Cette révolte est aussi celle d’un Thomas Bernhard, avec moins de violence. Non que la violence soit absente de Bobin, il l’écrit lui-même ; elle est dans ses mots, elle est près de lui, comme un enfant, mais elle s’exprime avec une sorte d’évidence qui est calme assumé, désir d’accord et non de rupture. Bobin cherche cet accord, tandis que Bernhard expose volontiers sa violence. Mais le sentiment d’aliénation produit par le travail est le même, qui conduit à l’écriture, à la lecture, dans la conscience très forte, et constante, qu’accepter l’emploi contraint du temps est renoncer à soi-même.
C’est cette pureté que porte La part manquante. Elle n’est pas naïve, cependant, elle n’est pas ingénue. C’est une pureté solitaire, extraite de la souffrance, y compris de la souffrance d’amour qui suppose elle aussi une contrainte, une perte de soi, à laquelle l’écrivain ne se résout pas.
Assez parlé. Nunc est legendum – il faut lire maintenant.
Thierry LE PEUT
*
* *
C’est le contraire de ce qu’on dit qui est le vrai. C’est toujours ce qui est tu, qui est le vrai. (p. 12)
L’homme ignore ce qui se passe. C’est même sa fonction, à l’homme, de ne rien voir de l’invisible. Ceux parmi les hommes qui voient quand même, ils en deviennent un peu étranges. Mystiques, poètes ou bien rien. Etranges. Déchus de leur condition. Ils deviennent comme des femmes : voués à l’amour infini. (p. 13)
On a un âge. On a un nom. On a une vie qui vous attend. Elle n’est pas faite pour vous, elle n’est faite pour personne. Elle vous attend. A huit ans on devine très bien ces choses-là, et qu’il faudra choisir. Choisir Dieu ou le vide, le travail ou le chômage, le désespoir ou l’ennui, choisir. Seulement voilà, on a trouvé autre chose, on a trouvé les livres, avec les livres on ne choisit plus, on reçoit tout. La lecture c’est la vie sans contraire, c’est la vie épargnée. On lit sous les draps, on lit sous le jour, c’est comme une résistance, une lecture clandestine, une lecture de plein vent. (p. 22)
On lit avec ce qu’on est. On lit ce qu’on est. Lire c’est s’apprendre soi-même à la maternelle du sang, c’est apprendre qui l’on est d’une connaissance inoubliable, par soi seul inventée. (p. 23)
Ce qu’on apprend dans les livres, c’est-à-dire « je vous aime ». Il faut d’abord dire « je ». C’est difficile, c’est comme se perdre dans la forêt, loin des chemins, c’est comme sortir de maladie, de la maladie des vies impersonnelles, des vies tuées. Ensuite il faut dire « vous ». La souffrance peut aider – la souffrance d’un bonheur, la jalousie, le froid, la candeur d’une saison sur la vitre du sang. Tout peut aider en un sens à dire « vous », tout ce qui manque et qui est là, sous les yeux, dans l’absence abondante. Enfin il faut dire « aime ». C’est vers la fin des temps déjà, cela ne peut être dit qu’à condition de ne pas l’être. La dernière lettre est muette, elle s’efface dans le souffle, elle s’en va comme l’air bleu sur la page, dans la gorge. « Je vous aime. » Sujet, verbe, complément. Ce qu’on apprend dans les livres, c’est la grammaire du silence, la leçon de lumière. Il faut du temps pour apprendre. Il faut tellement de temps pour s’atteindre. On va à l’aventure. On prend un livre dans ses bras, puis on le quitte, on va vers le suivant. (p. 24)
Ce n’est pas pour devenir écrivain qu’on écrit. C’est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour. (p. 26)
L’enfance fait comme un courant profond dans la rivière du jour. Vous y revenez souvent, comme on revient chez soi après beaucoup d’absence. (p. 29)
L’émerveillement n’est pas l’oubli de la mort, mais la capacité de la contempler comme tout le reste, comme l’amer et le sombre : dans la brûlure d’une première fois, dans la fraîcheur d’une connaissance sans précédent. (p. 31)
(…) le travail c’est d’être où l’on n’a pas choisi d’être, où l’on est contraint de demeurer – loin de soi et de tout. (p. 33)
Le futur n’existe pas dans l’enfance. Il n’y a ni passé ni futur dans la vie. Il n’y a que du présent, qu’une hémorragie éternelle de présent. (p. 34)
Le livre, on le découvre peu à peu. On le traîne avec soi depuis trois ans, on ne l’a pas terminé. On l’emmène en vacances, on l’ouvre au ciel d’été, de préférence. Comme si, pour le lire, il fallait retrouver une grandeur qui ne montre dans aucun emploi contraint du temps. Comme si, pour le lire, il fallait retrouver une pureté que jamais on n’aura, sinon dans la nostalgie qui vous en vient, au long des soirs d’été. (p. 41)
L’abondance des choses empêche de voir. La rumeur des pensées empêche d’entendre. (p. 42)
Il est bon d’être aimé. C’est comme atteindre ces îles si vertes que l’on désespérait d’un jour y aborder : les yeux et la pensée d’un autre. (p. 44)
Celui qui ne dort jamais (p. 45-52) :
C’est le genre d’homme qui peut tout faire, n’étant personne. (p. 47)
Le monde industriel c’est le monde tout entier, une fable noire pour enfants, une mauvaise insomnie dans le jour. La présence de l’argent y est considérable, autant que celle de Dieu dans les sociétés primitives. Elle irradie de la même façon. Elle gouverne le mouvement des pensées comme celui des visages. (p. 49)
Ils sont là comme des éboueurs de l’argent, comme des esclaves d’un nouveau genre, des esclaves millionnaires. Ils ordonnent, ils décident, ils tranchent. Ils parlent beaucoup. La parole est leur matière première. Ils parlent beaucoup mais ce n’est jamais une parole personnelle. Ils parlent suivant ce qu’ils font, suivant une idée générale de ce qu’il y a à faire dans la vie, une idée apprise. Ce sont les hommes du sérieux, les hommes sans ombre. L’éclat de l’argent égalise leurs traits. On dirait le même homme à chaque fois, la même absence hautaine, la même ruine de toute aventure personnelle, singulière. (p. 49-50)
Celui commande aux autres se met en position de Dieu. Celui qui commande et rit de ses commandements se met en position de diable. C’est un diable sans noirceur, un diable enfantin. (p. 51)
On apprend à voir comme on apprend à marcher après une longue maladie : pas après pas, songe après songe. (p. 55-56)
Ce fouillis des chambres d’enfants, vous le retrouvez dans la chambre d’écriture. (p. 59)
Il n’y a de connaissance que de ce qui meurt. Il n’y a de lumière que dans le noir. (p. 67)
Il y a la neige, il y a la voix. La neige descend du grand ciel lumineux de l’enfance. La voix fleurit sur les arbres du souffle. Dans le chant elle s’envole. Elle va dormir un temps auprès de Dieu. Elle redescend l’instant d’après, toute blanche et douce. Flux de la neige sous les ondes de la voix. Vagues de la voix sur les neiges du souffle. Nos attitudes devant la vie sont apprises durant l’enfance, et nous écoutons le chant des lumières comme un nouveau-né entend un bruit de source dans son cœur. Nos attitudes devant l’amour sont enracinées dans l’enfance indéracinable, et nous attendons un amour éternel comme un enfant espère la neige qui ne vient pas, qui peut venir. (p. 75-76)
Il y a des moments comme ça, on voit ce que c’est, le désir : la volonté exténuante de prendre, de jouir, de vaincre. (p. 80)
Il y a un creux sous votre nom. Il y a un trou dans le ciel. On a inventé le travail pour n’y plus songer. On a inventé le travail et le manège des chevaux de bois pour s’éloigner en vain de la place vide, au centre du centre, au cœur du cœur. (p. 89)
Vous connaissez cette tentation. Souvent vous connaissez cette envie de sortir du jeu, pour aller voir la lumière blanche dans le ciel large. Ce désir d’aller contre vos intérêts immédiats de travail ou d’amour, au nom d’un intérêt plus grand peut-être, ou bien au nom de rien. Allez savoir. (p. 89-90)
Le temps s’abîme dans un travail, dans des vacances, dans une histoire. Le temps s’abîme dans tous les emplois qu’on en peut faire. Peut-être écrire, c’est différent. C’est très près de perdre du temps, écrire, et ça prend tout le temps.
L’écrivain (p. 93-99) :
Il parle doucement. Il a cette courtoisie des contemplatifs, cette douceur farouche de ceux qui n’en ont jamais fait qu’à leur guise, que suivant une pensée d’eux-mêmes dans leurs jours, une pensée non apprise, solitaire. Sa violence est endormie dans sa voix. Elle remue légèrement sous les mots. (p. 96)
C’est quoi, réussir sa vie, sinon cela, cet entêtement d’une enfance, cette fidélité simple : ne jamais aller plus loin que ce qui vous enchante à ce jour, à cette heure. Emprunter ce chemin qu’on ne suit qu’à s’y perdre. (p. 97)
L’écrivain, c’est celui qui ne gagne aucune place – pas même la dernière. Celui qui se tient comme ça, debout, dans un rang de chaises vides. (p. 97)
L’écrivain c’est l’état indifférencié de la personne, la nudité indifférente de l’âme. De l’âme comme regard. De l’âme comme absence. Celui qui écrit s’en va plus loin que soi. (p. 98)
Ecrire c’est faire retentir sur la neige chaque pas de l’ange. (p. 99)





 Restant fidèle à sa « marque », qui est celle du roman en voix partagées, Laurent Gaudé porte sa plume vers Alexandre le Grand. En dramaturge, il concentre son récit autour d’une « crise », la mort du conquérant. Sur fond de guerre des diadoques (les héritiers d’Alexandre, qui se déchirent pour son empire dès la fin de sa vie), Pour seul cortège suit la trajectoire de plusieurs personnages qui accomplissent leur destin autour du corps du conquérant. Le partage n’est pas seulement celui du « royaume » d’Alexandre, c’est aussi celui du corps lui-même ; et puisque ce corps ne peut être partagé, l’enjeu est sa possession, dès lors que Ptolémée, l’un des héritiers, comprend que celui qui se rendra maître du corps d’Alexandre aura remporté une plus sûre victoire que celui qui réunira la plus grande armée.
Restant fidèle à sa « marque », qui est celle du roman en voix partagées, Laurent Gaudé porte sa plume vers Alexandre le Grand. En dramaturge, il concentre son récit autour d’une « crise », la mort du conquérant. Sur fond de guerre des diadoques (les héritiers d’Alexandre, qui se déchirent pour son empire dès la fin de sa vie), Pour seul cortège suit la trajectoire de plusieurs personnages qui accomplissent leur destin autour du corps du conquérant. Le partage n’est pas seulement celui du « royaume » d’Alexandre, c’est aussi celui du corps lui-même ; et puisque ce corps ne peut être partagé, l’enjeu est sa possession, dès lors que Ptolémée, l’un des héritiers, comprend que celui qui se rendra maître du corps d’Alexandre aura remporté une plus sûre victoire que celui qui réunira la plus grande armée.

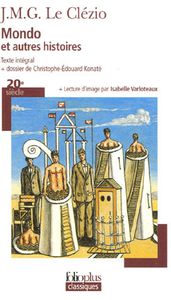
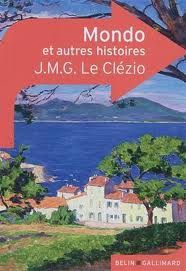

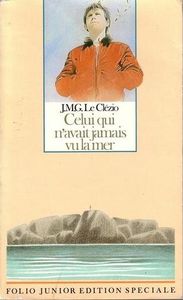

 Le Caravage... selon Fernandez
Le Caravage... selon Fernandez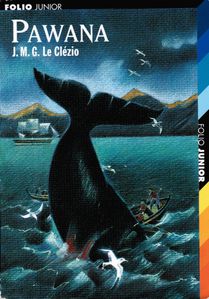 Pawana en indien nattick signifie baleine. Le récit de J.M.G. Le Clézio s’inspire de l’histoire vraie de Charles Melville Scammon, un baleinier qui découvrit une lagune où les baleines mettaient au monde leurs nouveau-nés, au Mexique. Etant venu y chasser les baleines, Scammon réalisa le crime qu’il était en train de commettre et se consacra dès lors à la sauvegarde des baleines. Celles-ci purent de nouveau venir dans la lagune et y mettre au monde leurs petits. Pawana, le récit de Le Clézio, se partage entre les voix de Scammon et de John, un garçon venu de Nantucket, sur la côte est des Etats-Unis, et qui participa à la première expédition de Scammon dans la lagune. L’un et l’autre se souviennent de cette expérience, mais aussi du monde tel qu’il était alors. C’était l’entrée dans un nouveau siècle, la fin de ce qui avait été jusque là. Le massacre des baleines raconté par Le Clézio est donc lourd du sentiment de perte qui caractérise non pas seulement le sort des baleines mais l’évolution du monde. C’est un récit mélancolique et beau à la fois : car l’écrivain restitue aussi la beauté de ce monde perdu, qu’il qualifie de monde des origines. Comment peut-on tuer ce que l’on aime ? semble demander le regard du jeune garçon au baleinier. Comment ose-t-on aimer ce que l’on a tué ? s’interroge à son tour le commandant Scammon. L’évocation de Pawana est celle d’amoureux de la mer, pénétrés du charme du « monde perdu » qu’ils découvrent, et ce charme côtoie l’horreur de la chasse aux baleines. Aux montagnes rougies par le soleil répond la mer de sang, dans un chant de douleur qui dit ce que l’on a perdu, et la peine d’avoir attenté à la beauté du monde. Le récit alterne ainsi les descriptions d’un paysage encore inviolé par l’homme et la narration des violences perpétrées dans ce décor. Le retour de John de Nantucket dans la lagune, des années plus tard, et de Scammon lui-même, oppose à la nature vierge de la première description celle, violentée, brutale, assassine de ce qu’est devenu le lieu envahi par les baleiniers du monde entier, les habitations et les usines de l’homme.
Pawana en indien nattick signifie baleine. Le récit de J.M.G. Le Clézio s’inspire de l’histoire vraie de Charles Melville Scammon, un baleinier qui découvrit une lagune où les baleines mettaient au monde leurs nouveau-nés, au Mexique. Etant venu y chasser les baleines, Scammon réalisa le crime qu’il était en train de commettre et se consacra dès lors à la sauvegarde des baleines. Celles-ci purent de nouveau venir dans la lagune et y mettre au monde leurs petits. Pawana, le récit de Le Clézio, se partage entre les voix de Scammon et de John, un garçon venu de Nantucket, sur la côte est des Etats-Unis, et qui participa à la première expédition de Scammon dans la lagune. L’un et l’autre se souviennent de cette expérience, mais aussi du monde tel qu’il était alors. C’était l’entrée dans un nouveau siècle, la fin de ce qui avait été jusque là. Le massacre des baleines raconté par Le Clézio est donc lourd du sentiment de perte qui caractérise non pas seulement le sort des baleines mais l’évolution du monde. C’est un récit mélancolique et beau à la fois : car l’écrivain restitue aussi la beauté de ce monde perdu, qu’il qualifie de monde des origines. Comment peut-on tuer ce que l’on aime ? semble demander le regard du jeune garçon au baleinier. Comment ose-t-on aimer ce que l’on a tué ? s’interroge à son tour le commandant Scammon. L’évocation de Pawana est celle d’amoureux de la mer, pénétrés du charme du « monde perdu » qu’ils découvrent, et ce charme côtoie l’horreur de la chasse aux baleines. Aux montagnes rougies par le soleil répond la mer de sang, dans un chant de douleur qui dit ce que l’on a perdu, et la peine d’avoir attenté à la beauté du monde. Le récit alterne ainsi les descriptions d’un paysage encore inviolé par l’homme et la narration des violences perpétrées dans ce décor. Le retour de John de Nantucket dans la lagune, des années plus tard, et de Scammon lui-même, oppose à la nature vierge de la première description celle, violentée, brutale, assassine de ce qu’est devenu le lieu envahi par les baleiniers du monde entier, les habitations et les usines de l’homme. L'écrivain chez lui
L'écrivain chez lui Un chapeau et des vies
Un chapeau et des vies Dans un pays en guerre
Dans un pays en guerre