TROIS FEMMES PUISSANTES, de Marie Ndiaye
NRF Gallimard, 2009
Conte(s) cruel(s)
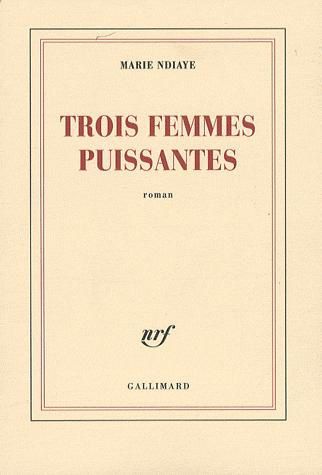 Les trois parties de ce roman paraissent distinctes mais se répondent par un effet d’échos, de reprises. Khady Demba, l’héroïne de la troisième partie, apparaît, fugace, dans la première partie, même s’il est difficile, en lisant le récit de sa vie, d’y replacer ce que nous apprenait cette première partie. De même, à mesure que le passé de Rudy Descas nous est révélé dans la deuxième partie, des lieux invitent à lier son histoire à celle que l’on a lue précédemment. Et cet oiseau en lequel Khady Demba semble finalement se métamorphoser répond à la buse menaçante qui poursuit Rudy Descas. Reprises, échos, liens ténus et jamais explicitement confirmés tissent donc entre les parties du roman un réseau de correspondances qui invite à l’appréhender comme un ensemble romanesque cohérent.
Les trois parties de ce roman paraissent distinctes mais se répondent par un effet d’échos, de reprises. Khady Demba, l’héroïne de la troisième partie, apparaît, fugace, dans la première partie, même s’il est difficile, en lisant le récit de sa vie, d’y replacer ce que nous apprenait cette première partie. De même, à mesure que le passé de Rudy Descas nous est révélé dans la deuxième partie, des lieux invitent à lier son histoire à celle que l’on a lue précédemment. Et cet oiseau en lequel Khady Demba semble finalement se métamorphoser répond à la buse menaçante qui poursuit Rudy Descas. Reprises, échos, liens ténus et jamais explicitement confirmés tissent donc entre les parties du roman un réseau de correspondances qui invite à l’appréhender comme un ensemble romanesque cohérent.
Les deux premières parties commencent par une longue phrase, très maîtrisée, qui fait entrer le lecteur dans le style de Marie Ndiaye. Un style fluide, élégant, on dira même classique, qui rend plus sensibles les écarts par lesquels le récit, parfois, est tout près de basculer. Car chacun de ces récits – ou chacune des parties de ce récit, puisqu’il s’offre comme un tout – conduit le lecteur au seuil d’un fantastique qui ne s’avoue pas forcément mais qui est bien là, insistant, d’autant plus inquiétant que le récit semble ne pas le désigner et continuer comme si rien d’étrange ne s’était passé. C’est le père de Norah perché dans son arbre, ce flamboyant que le narrateur mentionne constamment ; c’est la buse qui poursuit Rudy Descas où qu’il aille, ou même les anges dont l’existence est une certitude pour sa mère, ou encore cette scène pourtant si « réaliste » où Rudy contemple un artiste endormi et se rêve en train de l’assassiner, gratuitement ; c’est, enfin, l’oiseau qui clôt le roman, et qu’on est tenté, même si rien ne nous y invite, de rapprocher de celui qui refermait de façon funeste la deuxième partie. C’est, aussi, l’étrange malaise qui saisit le lecteur devant Norah qui urine sur elle-même, l’abandon du corps, son incontinence, créant une dissonance brutale dans le récit.
De fait, il est toujours question ici d’une perte de contrôle. Norah retrouve son père, affronte les sentiments contradictoires, pleins d’amertume, qui la lient à cet homme haï et pourtant si aimable, avec les autres ; elle est là pour réparer, résoudre ce qui a été fait avant son arrivée, mais on comprend vite qu’il y a bien plus à réparer, et surtout que Norah, l’avocate, dont le métier est de contrôler justement, ne contrôle rien, ni les événements qu’elle est censée redresser, ni son passé, ni même sa famille, dans laquelle elle a imprudemment laissé entrer un homme et une petite fille dont elle ne peut plus, aujourd’hui, se défaire et qui menacent de lui voler l’affection de sa propre fille. Cette idée de sécurité menacée, attaquée de l’intérieur, est aussi au cœur de l’histoire de Rudy Descas, qui un jour a perdu, lui aussi, le contrôle de sa vie, et qui depuis s’emploie à la détruire tout en rêvant de la corriger. Correction impossible car il ne maîtrise pas même ses émotions, débordé, submergé par la haine, l’envie, la rancœur. D’où vient cette malédiction qui condamne Rudy à l’amertume ? De son passé, là encore, un passé qui nous est dévoilé au fil de l’errance pathétique de Rudy, un passé ancré dans le même décor que celui de Norah, un passé marqué par la mort et la haine. Que dire enfin de Khady Demba ? Sa vie se déroule sous ses yeux sans qu’elle ait même le désir de la contrôler ; au contraire, elle s’abandonne à cet état de semi-conscience dans lequel elle a vécu et vit encore, se laissant emmener, voler, violer sans paraître comprendre, ou en comprenant que c’est son destin, et qu’il n’y a pas à le combattre.
Deux femmes encadrent un homme : le récit de la vie de Rudy Descas, de quelques heures dans la vie de Rudy Descas, est en effet encadré par l’aventure de Norah et celle de Khady Demba. Et sa vie même est placée tout entière sous l’influence de deux femmes, sa mère et sa femme. De l’une comme de l’autre le lecteur n’aura qu’un aperçu, le temps d’une rencontre ou de contacts désincarnés, par téléphone. Chacune de ces femmes, du coup, acquiert une présence quasi fantastique, et l’on voit bien qu’elles exercent plus de contrôle sur la vie de Rudy qu’il n’en possède lui-même. Car il faut bien déduire du titre du roman, et c’est ce qu’annonce d’ailleurs la quatrième de couverture, que Fanta est l’une des « trois femmes puissantes » que raconte Marie Ndiaye, alors même qu’elle n’apparaît pratiquement pas dans le roman.
Il est aussi toujours question d’enfants. C’est la fille de Norah et celle de son compagnon, c’est le fils de Rudy, l’enfant enfin que Khady Demba a attendu, autour duquel elle a conçu toute sa vie, pour son malheur, car elle n’a pas su profiter de son mari lorsqu’il était là, et a perdu avec lui tout soutien, tout allié. Plus tard, sur la route des migrations, elle espère, encore, la venue de l’enfant. La difficulté de communiquer avec ces enfants répond, autre écho, à l’impossible communication des parents avec leurs propres parents, comme s’il était impossible de surmonter cette incommunicabilité, qui s’exerce ici avec la puissance délétère d’une malédiction, impossible de ne pas la reproduire, de ne pas emmener ses propres enfants sur la voie des mêmes reproches, des mêmes souffrances, de la même insécurité.
On touche alors à la profonde douleur qui traverse ce roman. Sous le style élégant de l’écrivain serpente l’irrémissible souffrance des personnages, victimes de Parques implacables qui s’amusent à agiter et à couper les fils de leurs vies. Aussi Marie Ndiaye referme-t-elle chaque partie de son roman sur un « contrepoint » chargé d’espoir, d’un espoir doucement mélancolique, comme les impressions que l’on a au réveil, dans la brume d’un demi sommeil. Mais cela suffit-il à dissiper l’étrange oppression qui émane du roman ? Parce qu’ils ont la cruauté d’une réalité sans rédemption et l’apparente légèreté des contes, les récits de Marie Ndiaye méritent bien l’appellation de « contes cruels ».
Thierry LE PEUT


