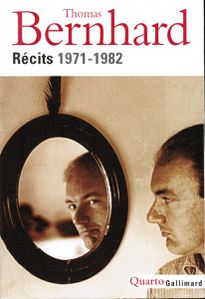
 L'ADOLESCENCE NOIRE D'UN OPTIMISTE INVETERE
L'ADOLESCENCE NOIRE D'UN OPTIMISTE INVETERE
L’origine, publié en 1975 (et en France en 1981 dans une traduction d’Albert Kohn, aux éditions Gallimard), est le premier des récits autobiographiques de Thomas Bernhard. Il comporte deux parties : la première, « Grünkranz », évoque le foyer national-socialiste de la Schrannengasse à Salzbourg, qu’intègre Bernhard à treize ans, en 1944, lorsqu’il est inscrit au collège Saint-André – Grünkranz étant le nom du directeur de cet internat - ; la seconde, « Oncle Franz », évoque le lycée que fréquenta ensuite l’auteur, toujours logé au même internat passé après la guerre sous la « coupe » du catholicisme et dirigé par le « débonnaire » « Oncle Franz » (le surnom donné au directeur) mais administré en fait par un préfet des études aussi sadique et redouté que le national-socialiste Grünkranz.
L’origine est une charge contre la ville de Salzbourg et contre l’éducation administrée par les établissements de l’époque – et l’éducation en général, en tout cas l’éducation publique, l’éducation de masse. Les années passées dans cette ville et dans ces établissements – l’internat national-socialiste puis catholique, et le lycée – sont décrites comme des années de destruction et d’anéantissement de la personnalité et de l’esprit de l’enfant que fut Bernhard – destruction et anéantissement qui désignent le sort de tous les élèves mais dont l’auteur a pleinement conscience alors qu’elle semble vécue comme normale par les autres. Hors les murs des établissements et de la ville elle-même, c’est le processus même d’éducation que condamne l’écrivain, accusant les parents dans leur ensemble de commettre un crime en mettant au monde des enfants qu’ils s’emploient ensuite, dès les trois premières années de leur vie, avant même donc de les placer dans des établissements qui prendront ensuite la relève, à détruire et anéantir. Bref, une entrée en matière idéale pour comprendre pourquoi Thomas Bernhard est souvent présenté comme un auteur acide, capable d’écrire les choses les plus dures dans un style pourtant dénué d’agressivité.
Grandir à Salzbourg est, selon l’écrivain, une expérience traumatisante. « Celui qui a grandi dans cette ville selon le désir de ceux qui possèdent sur lui un droit d’éducation mais contre sa volonté », écrit Bernhard, « est enfermé dans son enfance et sa jeunesse comme dans une forteresse d’angoisse, de terreur. » (Quarto Gallimard, p. 47-48 ; nous coupons la phrase, plus longue, et en altérons donc le sens général.) « Très souvent il m’a été donné de reconnaître et d’aimer l’essence particulière, la singularité absolue de ce paysage, mon paysage – paternel et maternel – fait de nature (célèbre) et de d’architecture (célèbre) mais toujours les habitants imbéciles qui existent dans ce paysage, cette nature, cette architecture et s’y multiplient inconsidérément d’année en année, leurs lois vulgaires et leur interprétation encore plus vulgaire de ces lois qui leur appartiennent ont immédiatement étouffé en moi la conscience et l’amour de cette nature (en tant que paysage) qui est une merveille, de cette architecture qui est une œuvre d’art, toujours ils les ont immédiatement étouffés dès leurs premiers germes, toujours les moyens de mon existence qui ne font appel qu’à moi-même furent immédiatement sans défense contre la logique petite-bourgeoise qui règne dans cette ville comme en aucune autre. Tout dans cette ville s’oppose à l’esprit créateur. On a beau prétendre le contraire d’un ton de plus en plus véhément, cette ville a l’hypocrisie pour fondement, c’est l’ineptie qui est sa plus grande passion, et l’on extermine l’imagination, partout où elle peut apparaître. Salzbourg est une façade perfide sur laquelle le monde peint sans interruption sa mystification et derrière laquelle l’esprit (ou l’individu) créateur doit nécessairement s’étioler, dépérir et mourir à petit feu. » (p. 48-49)
On comprend que les lecteurs de Bernhard aient pris ombrage de cette charge, surtout s’ils habitaient Salzbourg. Mais ce n’est rien encore. Dans le dessin qu’il fait de l’internat national-socialiste puis catholique où il a passé des mois de son enfance, pendant et après la guerre, Bernhard s’attaque à l’état d’esprit petit-bourgeois de cette ville et assimile les deux « régimes », ou les deux autorités, qui ont présidé à l’éducation des jeunes gens sous la férule de l’uniforme brun puis de la redingote noire. Le Christ aura remplacé Hitler mais le fonctionnement de l’établissement, pas plus que sa nature, n’auront vraiment changé, tant la « morale » nationale-socialiste et la « morale » catholique sont à l’image de l’esprit même que Bernhard attribue à Salzbourg. Peu importe cependant au lecteur d’aujourd’hui, et français de surcroît, que la peinture de Bernhard soit exacte ou non. Subjective, elle livre le point de vue de l’écrivain, qui lui-même entend présenter le point de vue de l’adolescent qu’il a été. Surtout, la dénonciation – ou démystification – à laquelle se livre l’auteur de L’origine peut être élargie à toute la société humaine, et Salzbourg n’est que la boîte de Pietri dans laquelle l’écrivain a observé ce qu’il décrit ici.
On s’en convaincra facilement en lisant l’ensemble du livre, la condamnation sans appel des parents en général – l’acte de procréation en lui-même est dénoncé comme un acte irresponsable commis par des adultes eux-mêmes préalablement détruits et anéantis par la société et qui perpétuent l’erreur humaine en condamnant à leur tour le fruit de leur crime à cette entreprise de destruction et d’anéantissement dont ils sont les complices – comme du « système » d’éducation dans la description duquel on sent toute la haine de l’écrivain pour toute forme de soumission de l’individu à ce qui n’est rien d’autre qu’une gigantesque entreprise de conditionnement à l’échelle de l’espèce tout entière. Bref, en s’en prenant à Salzbourg, Bernhard s’en prend en fait à l’humanité entière, à la société dans son ensemble, au sein de laquelle il ne trouve guère que quelques individus à racheter. Sa charge est celle d’un homme qui, promis comme les autres à l’anéantissement, a décidé dès quinze ans de fuir le « système » pour vivre par ses propres moyens, en refusant le diktat du lycée et de la société.
Evoquant son passage au lycée, l’écrivain y distingue deux figures qu’il singularise pour les besoins de sa démonstration. Il s’agit, d’une part, d’un élève infirme, d’autre part d’un professeur de géographie que sa laideur et sa soumission ont désigné comme un bouc émissaire idéal. Ces deux êtres sont, selon les critères de Bernhard, l’illustration même du comportement d’une « société », qui toujours se moque de ses éléments les plus faibles et entreprend de les détruire en les désignant à la moquerie et à la violence générales. « A propos de l’infirme, le fils de l’architecte, tout comme du professeur de géographie Pittioni, j’ai pu voir jusqu’à quel degré d’abjection peuvent aller la moquerie, la dérision, la destruction et l’anéantissement de ces victimes offertes à la communauté et à la société : toujours jusqu’à l’extrême degré et très souvent au-delà puisque ces victimes sont tuées sans autre forme de procès. » (p. 120 - c’est l’auteur qui souligne.)
S’il n’est pas infirme, si la nature ne l’a pas fait aussi laid que le professeur de géographie, Bernhard se voit lui-même en victime. « Il me semblait que je formais un trio avec ces deux êtres auxquels je viens de penser : le fils d’architecte estropié et le professeur de géographie Pittioni, mais à la différence de ces deux-là, chez lesquels on voyait leur infortune partout et en toutes choses, ma propre infortune était cachée profondément en moi et dans mon caractère introverti par nature. » (p. 124) De là le fait que Bernhard a échappé aux « tracasseries » des deux autres, parce qu’il a su « rendre invisible » sa propre fragilité, sa différence ; « je réussis presque toujours à masquer mon état d’âme effectif en affichant un état d’âme qui ne donne aucune espèce de lumière sur mon état d’âme effectif. » Confidence qui vaut sans doute pour le comportement de Thomas Bernhard l’homme dans la vie, mais aussi pour l’écrivain Thomas Bernhard, qui s’est construit un « personnage » en littérature tout en affirmant dire la vérité, sa vérité, sans rien travestir (comme il le suggère en citant avec insistance Montaigne, auteur chéri de son grand-père qui fut le seul éducateur reconnu comme valable de Bernhard).
La figure du grand-père, justement, se distingue dans L’origine, comme dans d’autres récits de Bernhard. Description réaliste et exacte du grand-père de l’écrivain, ou recréation en partie construite du personnage, le grand-père est en tout cas l’une des rares figures d’éducateur que le récit rachète. La force du personnage explique d’ailleurs en partie l’échec de Bernhard au lycée et sa vision du monde : car il est entré au lycée et il a fréquenté Salzbourg après avoir déjà reçu l’éducation de son grand-père, éducation prodiguée notamment au cours de promenades dans la nature. Le grand-père de Bernhard est une figure d’homme instruit mais solitaire, qui ne trouve pas sa place dans la société. C’est un homme d’un pessimisme certain sur la société, sans illusion sur les établissements d’éducation et qui pourtant a voulu y faire entrer son petit-fils. A travers lui, le grand-père voulait sans doute réaliser ce qui lui avait été refusé : lui n’avait pas intégré le lycée, lui n’avait reçu qu’une instruction technique, qu’il a complétée en autodidacte. De là une contradiction que Bernhard évoque et analyse : comment son grand-père a-t-il pu le pousser au lycée alors que ce lieu était de nature à le détruire, à exercer sur lui une influence traumatisante, ce que le grand-père savait fort bien ? L’enfant Bernhard a en nourri un sentiment de trahison que ne se cache pas l’écrivain Bernhard, et qui pourtant n’enlève pas au grand-père l’aura qu’il conserve ailleurs sous la plume de l’auteur, notamment dans Un enfant et dans Le froid.
Le style de Bernhard est constitué de phrases souvent longues, qui se déploient pour intégrer les mouvements de la pensée en même temps que plusieurs nuances de la réalité. L’ensemble forme un bloc compact qu’il faut quasiment lire d’une traite pour éviter d’y faire entrer des coupures dont Bernhard n’a pas voulu, limitant même le nombre de paragraphes pour ne pas interrompre le mouvement général de l’œuvre. A l’évocation de l’internat se mêle celle des bombardements sur Salzbourg à la fin de la guerre, qui souffle à l’écrivain des descriptions poignantes sur la destruction – matérielle celle-ci – semée par la guerre, mais complète aussi le « portrait » de la ville en y montrant les hommes et les esprits au moment de la détresse la plus grande et du dénuement total. « L’odeur de décomposition reposa encore des années sur la ville et ses bâtiments reconstruits, sous lesquels, pour simplifier les travaux, on avait laissé les morts. […] Une tristesse profonde, atteignant à présent tout à coup sa vraie profondeur, s’était emparée des habitants, elle était dans chacun d’eux car les dommages paraissaient n’être plus réparables. Durant des années cette ville n’a rien été d’autre qu’un tas de décombres puant l’odeur douceâtre de la décomposition, où, comme par dérision, tous les clochers étaient restés debout. Et l’on eût dit qu’à présent la population s’appuyant sur ces clochers se relevait lentement. » (p. 94) La description bien sûr se superpose à celle de l’esprit de la ville, où le catholicisme, comme renaissant des cendres du national-socialisme, se substitue sans aucune difficulté au nazisme écrasé par les bombes. Mais elle se donne aussi comme le portrait saisissant d’une ville au lendemain de la guerre, détruite par la guerre, se relevant pourtant, dans et malgré la misère, dans et malgré la tristesse.
Peu de lumière s’échappe de l’évocation de Bernhard – ou y entre. L’origine donne un accès direct à la réalité noire que l’écrivain dit avoir vécue. La fin, cependant, s’offre comme une ouverture : après avoir souffert des mois durant de sa vie au lycée et à l’internat, le jeune Bernhard d’abord se protégea de la souffrance en acquérant la certitude qu’elle « allait bientôt se terminer », ensuite s’en détacha effectivement en décidant, un jour, de ne pas entrer dans l’établissement scolaire mais, au lieu de cela, dans le bureau de l’Office du travail, qui lui trouva une place d’apprenti dans un magasin d’alimentation. Une pensée accompagne, chez le lecteur d’aujourd’hui, cette évocation de la fuite : la simplicité avec laquelle l’adolescent s’écarte de la route tracée pour décider et obtenir, en un jour, en une seule démarche, une place d’apprenti. C’est la pensée que peut-être, aujourd’hui, la simplicité de cette fuite n’est plus possible.
Le sous-titre de L’origine est « Simple indication ». Plusieurs fois au cours du récit l’auteur précise qu’il ne s’agit pas pour lui d’analyser profondément son adolescence, ni l’impression si puissante qu’a laissée en lui la ville de Salzbourg. Son but est de donner au lecteur une indication, « une simple indication », de ce que fut son état d’esprit. « A cet endroit il me faut répéter que je note ou ne fais qu’esquisser ou indiquer comment j’ai ressenti l’état de choses qui existaient alors et non comment je pense aujourd’hui car ce que j’ai ressenti alors est autre chose que mon mode de pensée d’aujourd’hui. » (p. 98) « Ce qu’on trouve ici, ce sont uniquement des indications de pensées et de sentiments constamment pensées et ressenties par celui qui les note et qui, tout au moins, l’irritent toujours et dans toute son existence et ne le laissent pas en repos. » (p. 102) « Mais je ne fais qu’indiquer. » (p. 103) « Mais, comme tout ce qui est noté ici, cela aussi ne peut être qu’une simple indication. » (p. 110)
Il faut donc prendre L’origine comme « une simple indication » de ce que Thomas Bernhard a pensé et ressenti lorsqu’il était adolescent (de treize à quinze ans), mais une indication tout de même de ce qu’il pense et ressent encore en écrivant ce récit. Une simple indication sur un état d’esprit d’une lucidité cruelle et d’un pessimisme sans appel sur la société qui l’a vu naître et, malgré sa tentative de le détruire et de l’anéantir, n’a pu faire taire sa voix singulière, qui s’impose encore avec tant de force. On découvrira plus tard que le sanatorium où se déroule l’essentiel de Le froid est décrit comme un enfer sur terre : c’est aussi le cas de Salzbourg dans L’origine, et du lycée où Thomas Bernhard a tant souffert, en silence, avant de ne plus se résoudre à parler.
P.S. : Bernhard, paraît-il, pouvait rire très fort en se relisant. C’est que, en dépit de l’obscurité pessimiste de ses textes, l’auteur n’abdique pas la capacité de se moquer, et d’abord de lui-même. Ainsi de l’idée de suicide, très présente dans ce texte et dans d’autres. L’idée en soi n’est pas spécialement optimiste ou réjouissante. Mais la façon dont Bernhard évoque le cabinet aux chaussures de l’internat, petite pièce où on l’envoyait travailler son violon, et l’idée de suicide qui l’y accompagnait invariablement, est en soi un bel exemple d’humour noir. Le suicide, dans L’origine, est concomitant au placement dans l’internat : « Que ceux qui l’aimaient, comme il l’a toujours cru, l’ont jeté en pleine conscience dans ce cachot construit par l’Etat, il ne le comprend pas, ce qui l’occupe en premier lieu, dès les premiers jours, c’est naturellement l’idée de suicide » (p. 51, l’auteur parle de l’enfant qu’il était à la troisième personne). « Etouffer la vie ou l’existence pour ne plus être forcé de les vivre et d’exister, mettre fin à cette misère et à cette détresse complètes, soudainement apparues, en sautant par la fenêtre ou en se pendant par exemple dans la petite pièce où l’on range les chaussures, au rez-de-chaussée, cela lui paraît la seule chose à faire mais il ne la fait pas. » (p. 51) Y penser, mais ne pas le faire. Cette opposition est récurrente chez l’écrivain ; la possibilité de la mort, la conscience de pouvoir mettre fin à la vie à tout moment, du fait de sa propre volonté, est présentée comme une force dans la bouche du grand-père, et cette idée est imprégnée dans l’esprit du petit-fils dès l’enfance. C’est avec la phrase suivante que s’immisce l’ironie : « Toujours quand il travaille le violon dans la petite pièce où l’on range les chaussures – elle lui a été attribuée par Grünkranz parce qu’il travaille le violon – il pense au suicide, c’est dans la petite pièce où l’on range les chaussures que les possibilités de se pendre sont les plus grandes, obtenir une corde n’implique pour lui aucune espèce de difficulté et dès le second jour il fait un essai avec ses bretelles mais abandonne cet essai et travaille son violon. » L’image de l’enfant essayant de se suicider avec ses bretelles est partagée entre l’humour noir et le drame ; elle serait dramatique si l’on s’y attardait, mais elle est chassée aussitôt qu’énoncée, et remplacée par une activité a priori sans rapport avec la mort, sans lien direct avec l’idée de suicide : le travail du violon. Et l’écrivain de s’attarder sur l’idée de suicide tout en décrivant la pièce aux chaussures et en évoquant longuement la place du violon dans l’existence de l’enfant. Tout le passage procède par avancées et répétitions, ces dernières lui conférant une tonalité musicale et naïve, d’une naïveté qui génère l’ironie. Tout ici se mêle, à la fois désamorçant l’idée de suicide et soulignant la manière dont elle se fond dans l’existence banale de l’enfant. Non réalisée, elle est néanmoins constante, elle est l’une des émotions du quotidien, mise au même plan que l’odeur de chaussures et les exercices répétitifs du violon.
Thierry LE PEUT
L'ORIGINE, de Thomas Bernhard
1975 - Gallimard, 1981
traduit de l'allemand par Albert Kohn
Thierry LE PEUT


