CONTES DE LA SOLITUDE d'Ivo Andric
Livre de Poche
Journal de lecture
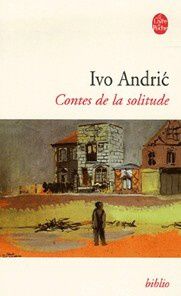 Deux parties se distinguent au fil de la lecture. Dans la première dominent les personnages, présentés comme des visiteurs plus ou moins indésirables, qui s’invitent, s’arrêtent ou s’imposent à un narrateur qui n’est lui-même que de passage dans cette maison isolée qu’il décrit au seuil du recueil. Des personnages issus du passé, aristocratiques d’abord, plus communs ensuite. Des fantômes, puisque tous sont morts. Des « héros » empanachés ou des gens ordinaires, enterrés tout près, ou qui ont vécu là, sont passés par là. L’occasion de portraits dans lesquels Ivo Andric saisit les nuances de l’homme, pris dans le tumulte d’une vie, celui des guerres et de la passion. Des portraits colorés, « cyranesques » comme celui de Bonneval pacha, pathétiques comme celui d’Ali pacha. Tous, d’ailleurs, ont quelque chose de pathétique, car aussi haut qu’ils se hissent c’est leur chute qui éclaire finalement leur destinée, au moment du crépuscule. C’est souvent au crépuscule que s’intéresse Andric, car c’est le moment qui donne sens, celui où, proche de la fin, on enveloppe d’un regard, d’une phrase, l’ensemble d’une vie.
Deux parties se distinguent au fil de la lecture. Dans la première dominent les personnages, présentés comme des visiteurs plus ou moins indésirables, qui s’invitent, s’arrêtent ou s’imposent à un narrateur qui n’est lui-même que de passage dans cette maison isolée qu’il décrit au seuil du recueil. Des personnages issus du passé, aristocratiques d’abord, plus communs ensuite. Des fantômes, puisque tous sont morts. Des « héros » empanachés ou des gens ordinaires, enterrés tout près, ou qui ont vécu là, sont passés par là. L’occasion de portraits dans lesquels Ivo Andric saisit les nuances de l’homme, pris dans le tumulte d’une vie, celui des guerres et de la passion. Des portraits colorés, « cyranesques » comme celui de Bonneval pacha, pathétiques comme celui d’Ali pacha. Tous, d’ailleurs, ont quelque chose de pathétique, car aussi haut qu’ils se hissent c’est leur chute qui éclaire finalement leur destinée, au moment du crépuscule. C’est souvent au crépuscule que s’intéresse Andric, car c’est le moment qui donne sens, celui où, proche de la fin, on enveloppe d’un regard, d’une phrase, l’ensemble d’une vie.
Puis, à mesure que l’on comprend que c’est en effet la vie dont ces textes cherchent à détacher le sens, les textes paraissent plus universels, ils se détachent du portrait, du singulier, pour embrasser une ville, un pays. Les personnages, comme ces deux Ibrahim de « Conversation du soir », ne sont singuliers que pour exprimer une vérité plus générale, qui ne vaut pas seulement pour Sarajevo, ou la Bosnie, mais pour l’homme, universellement. Aussi certains textes, comme les « Deux écrits du scribe bosniaque, Drazeslav », ou « Le vainqueur », même s’ils restent ancrés dans une réalité historique explicite, se rapprochent-ils de ce que s’autorise la fantasy, des tableaux universels qui, au-delà de leurs caractéristiques singulières, synthétisent l’Histoire. Il y est beaucoup question de celle-ci mais aussi de l’homme, de l’âme, du mouvement qui les balance, d’un extrême à l’autre, d’un état à l’autre, dans un mouvement qui évoque parfois l’Ulysse de L’Odyssée (les pensées du scribe bosniaque sur le voyage, et sur les étrangers qu’il rencontre, qu’il apprend à connaître), et qui ramène à l’inéluctable répétition des mêmes passions à travers l’histoire (le récit incompréhensible de Skaro dans « Conversation du soir »).
Le recueil se referme sur le portrait de Sarajevo, dans lequel se mêlent les époques, comme dans une ode au Temps.
Prologue
D’abord un lieu. Puis un moment. La maison où le narrateur dit avoir passé tout un été, une maison entre passé et présent, un témoignage, par son architecture, du mélange de deux époques, un lieu empreint de cet attachement à la vie pour elle-même, de cette paix que l’on cherche ou que l’on désire en la fuyant souvent. Un matin d’été, quand la brume des rêves accompagne le narrateur qui voudrait écrire, s’emparer de ces formes, de ces personnages, de ces rêves, mais sait qu’il n’y arrivera pas. Et d’autres fois, quand au contraire les personnages s’imposent, s’offrent d’eux-mêmes, l’écrivain n’a rien d’autre à faire que de noter tout ce qui vient ainsi, sur le papier déjà prêt.
Ainsi les personnages des nouvelles qui suivent, de certaines d’entre elles, sont présentés comme des « visiteurs » parfois envahissants dont l’écrivain accepte la présence. L’écrivain reçoit, accueille, et transcrit.
Bonneval pacha
« Le plus bruyant et le plus fougueux de mes visiteurs semble être l’arrogant et ventru Bonneval pacha… »
Portrait bigger than life, grotesque sans être ridicule, écrit Andric, d’un descendant de noblesse française exilé durant deux ans à Sarajevo. Sa vie, ses hauts faits, ses changements de camp, sa personnalité : tout concourt à dessiner l’image d’un homme à la fois invraisemblable et fascinant, un personnage de roman dont l’ancrage dans la réalité est tel pourtant qu’il en acquiert une forme de réalité. Ainsi l’image s’imprime dans l’esprit du lecteur, comme elle s’est imposée dans celui du narrateur.
Ali pacha
De Bonneval pacha on avait le portrait. D’Ali pacha on a l’histoire, mais le récit développe surtout un événement, celui de la chute d’Ali pacha, le « petit empereur d’Herzégovine », mené sur une mule, qu’il montait à l’envers et que tirait son fils, à travers les villes et villages de son petit empire, quand Omer pacha vint s’emparer de l’Herzégovine au nom du sultan. Le narrateur s’applique à rendre les circonstances de l’événement et la psychologie des personnages, à travers leur comportement comme à travers leurs pensées. Ainsi du regard que le fils porte sur son père, regard d’admiration et de honte à la fois, au moment de le conduire devant son destin. Le petit empereur furieux, courroucé, qui jette un regard sévère sur son pays au début, devient vieillard accablé et pathétique, puis sorte de derviche mendiant éclairé, soudain plus sensible à la souffrance de son peuple qu’à sa propre situation. C’est ce renversement que conte le récit, achevé par la balle que tire un soldat dans la tête d’Ali pacha, et qui met fin à l’histoire. Mais il reste d’Ali pacha cette conversion qu’il vient conter au narrateur, qui la transmet à son lecteur. L’histoire d’un homme qui, au revirement du destin, ne s’est pas résigné mais s’est adapté. A changé. De sorte qu’il reste de lui une image qui passe outre la mort, et qui apprend quelque chose aux vivants, bien plus tard encore.
Le baron
Portrait saisissant de vérité d’un menteur impénitent. Le baron ne peut se résoudre à dire les choses comme elles sont, juste comme elles sont, sans y rien ajouter. Car telles elles sont trop tristes, insipides. C’est ce désespoir que conte admirablement cette nouvelle. Le désespoir de vivre dans un monde dont la vérité est si terne et si banale que le baron ne peut tout simplement les dire sans vouloir aussitôt les enjoliver, les embellir, les compléter pour les rendre intéressantes, dicibles. Objet de risée, il est moqué par ses collègues fonctionnaires, déchu de son aristocratie, condamné au mépris. Il rêve alors d’un homme qui le pourrait croire, rien qu’une fois, le croire sans condition, sans réserve, sans l’ombre d’un doute : un sauveur ! Mais il ne trouve que le raki, dans lequel il se noie. Car seul l’art aurait pu sauver un tel homme, répondre à un besoin si essentiel, si entier, si absolu de remplacer ou de prolonger la vérité du monde par une vérité plus consistante, plus exaltante. Ivo Andric lui-même ? (Voir la préface du recueil.) Voire.
Le géomètre et Julka
L’homme est cette fois ordinaire, banal même. C’est un petit géomètre qui s’invite dans le salon du narrateur, avec réserve mais détermination. C’est un petit géomètre rencontré un jour dans un train, visiblement désireux de parler, mais que le narrateur n’avait pas voulu écouter. Se plongeant dans un livre, il s’était assis à l’écart, bien que conscient du regard implorant du petit homme. Et voilà que celui-ci vient dans son salon, et lui dit ce qu’il aurait voulu lui dire ce jour-là. Ce petit homme est mort, suicidé, croit-on. Il raconte sa vie avec Julka, sa femme, insatisfaite, volage. Julka qui courait avec le premier officier venu, Julka dont tout le monde connaissait l’attitude, Julka à qui il expliquait l’inconvenance de sa conduite mais qui n’écoutait pas, qui n’entendait pas, qui même ne semblait pas comprendre ce qu’il lui expliquait, et dont le regard fixait toujours un point derrière son mari, comme si elle ne le voyait même pas. Le désespoir de Julka était le désespoir du géomètre. C’est sa confidence que fait entendre ce récit, au terme duquel il se retire, alors que le narrateur, cette fois, voudrait parler. Ici, comme dans « Le cirque », il s’agit de compléter le souvenir, de raconter ce qui ne s’est pas passé, de combler ce qui, s’imposant par sa non réalisation, devait bien se passer dans l’esprit du narrateur. Extrait de la nouvelle suivante, « Amours », qui concerne les lieux mais s’applique très bien au géomètre : « Ainsi villes, rues et maisons, ou seulement des parties de rues et de maisons, jaillissent dans mon esprit et me posent de nouvelles questions ou exigent de moi, telle une dette impayée (je souligne), une réponse aux anciennes questions jadis laissées sans réponse. » (p. 84)
Amours
Les lieux aussi s’invitent parfois dans la maison du narrateur. Ici le sud de la France. Mais très vite c’est bien une personne qui s’impose, une femme rencontrée dans un café, à qui le narrateur a offert un repas et qu’il a accompagnée chez elle. Là, elle lui conte sa vie d’animal avec un homme qu’elle aime et qui la bat. Elle dit son malheur, et il écoute. Elle dit qu’un jour elle le tuera, cet animal, et pourtant elle ne peut s’empêcher de l’aimer, et lui ne peut s’empêcher de revenir. Le narrateur la laisse. Il rentre à son hôtel confus, comme abattu.
Le cirque
Un état d’âme issu d’un rêve conduit le narrateur à évoquer un souvenir d’enfance. La première expérience du cirque et de l’impression profonde que cette expérience a laissée dans l’esprit de l’enfant, avant d’être détruite par la fin du spectacle : si tout cela ne dure pas, à quoi bon ? c’est que cela n’existe pas ! Et voilà qu’ayant rappelé ce souvenir le narrateur est visité par un mort, le directeur du cirque dont il s’est souvenu, invoqué par la force du souvenir. Et le directeur lui raconte ce qu’il n’a jamais su, et ne pouvait savoir, enfant : son amour insensé, passionné, alors qu’il était déjà un homme mûr et marié, pour une jeune funambule. Leur mariage et le changement brutal de la bien-aimée. Sa décision de la tuer, parce qu’elle représentait à ses yeux la mort dont il devait se défendre. Son procès, sa condamnation, sa mort. Ce drame vient « compléter » le souvenir d’enfance, « Car chaque chose, dans la vie, doit être éclairée de tous les côtés. » Et le narrateur est le récepteur du souvenir, comme il l’a été d’un état d’âme induit par ce souvenir, comme il l’est du récit du mort. Il en reste une impression d’étrangeté, de vanité, comme un vertige dont on ne prend pourtant pas conscience à la lecture, car tout arrive comme naturellement, linéairement. Le passé, le présent, l’événement, l’état d’âme se mêlent en une seule impression étrange.
L’esclave
Ce n’est pas le personnage qui est venu se raconter, ce n’est pas non plus un lieu. C’est « le balancement dense et régulier de la mer chaude qui, dans l’obscurité, vient obstinément heurter les fondations de l’antique et sombre forteresse de Novi ». Ce bruit est venu au narrateur dans son sommeil, avec son histoire.
L’histoire d’une esclave, au lendemain de la campagne d’Herzégovine. Tandis que discutent âprement le vendeur et l’acheteur, l’esclave dans sa cage en arrive à la conclusion que la seule issue au malheur est la mort. Elle se pend en coinçant sa nuque entre deux barreaux. C’est sa mort, toutes les pensées qui la traversent, les sensations qui passent en elle, que conte ce récit. Pour finir sur le désarroi des gardes se demandant lequel d’entre eux osera prévenir le marchand d’esclaves.
C’est un récit sur la futilité. Futilité du discours du vendeur comme de celui de l’acheteur, futilité des motivations de ce dernier et du fait même d’acheter une esclave, futilité de ses désirs, de son insatisfaction, futilité de l’existence quand on n’est qu’esclave. Tout le monde est esclave, c’est la conclusion à laquelle en arrive l’esclave, car sont esclaves aussi ceux qui la vendent et ceux qui l’achètent, ceux qui la gardent, tous ceux qui vivent autour d’elle. Sont esclaves tous ceux qui ne vivent pas librement dans le village dont elle a été arrachée, et qui n’existe plus, qui a disparu dans les flammes, dont les habitants sont maintenant dispersés dans différents pays, en esclavage. Tout ce que font les personnages, tout ce qu’ils disent, est ainsi frappé de cette évidence de la futilité, comme l’échange du marchand et de l’acheteur, dont chacun a conscience de l’artifice de son discours et du discours de l’autre, mais n’en continue pas moins de négocier, tandis qu’à quelques pas l’esclave se tuant fait disparaître l’objet même de leur négociation.
Zouya
Zouya, petite fille puis vieille femme, a toujours vécu avec les Aleksic, là-haut, dans les collines. Enfant, le narrateur la connaissait ; il a connu son chuintement si particulier, ce marmonnement qui n’était ni un chant ni un langage humain. Et quand elle le visite chez lui, ce jour-là, et qu’elle a fini de lui parler longuement des Aleksic, il s’enfonce dans ce chuintement et entend une histoire. L’histoire de Zouya qui, dans les temps de guerre, saisissait toutes les occasions de s’éloigner de la maison, en dépit des mises en garde et des menaces, pour aller écouter le chant de l’eau au-dessus du bief, appuyée sur la poutre. Jusqu’au soir où un homme l’a surprise là, et qu’elle savait qu’elle aurait dû fuir mais qu’elle n’a pas fui, et que cet homme l’a pliée, écrasée, laissée là sans connaissance. Elle s’est rétablie, elle a repris la vie comme avant, et comme après. C’est ce moment que raconte le chuintement, cette histoire avec laquelle s’endort le narrateur. A son réveil, Zouya n’est plus là. Elle a disparu, tel un fantôme.
« Je suis habitué, depuis que je vis dans cette maison, aux hôtes qui apparaissent brusquement, se comportent étrangement, et disparaissent ensuite à nouveau tels des fantômes ».
Le prince aux yeux tristes
Un prince aux yeux tristes, la femme d’un artiste, ardente, et un crachat qui marque la chute… Il était une fois, dit le conte à son début – car c’est un conte. Au service de ce prince aux yeux si tristes se mit un jour la femme d’un artiste. Elle s’y mit précisément à cause de ces yeux, qui emplissaient les visiteurs d’un sentiment de profondeur et d’admiration. Le prince ne parlait guère, sa principauté était si petite qu’il en franchissait les frontières en s’y promenant, mais son regard, ses yeux tristes, cela semblait faire la force de ce prince. Puis la femme, ne recevant rien de lui, se découvrit insatisfaite. L’admiration un jour disparut, la dévotion s’en fut, et ne resta que le mépris. Elle vit brusquement le prince comme ce qu’il était. Et tandis qu’il parlait avec ses sujets au pied de l’arbre planté au centre de la principauté, elle franchit ce cercle, elle lui cracha au visage. Le prince devint aveugle et perdit sa principauté. Tous le méprisèrent, nul ne l’aida, il ne se trouva pas même un chien pour l’accompagner. Il erre, seul, aveugle et affamé.
On retrouve la femme insatisfaite, la femme que ses besoins sensuels inassouvis rendent quasiment diabolique, et dont le mépris plonge l’homme dans l’abîme. (Voir « Le cirque » et « Le géomètre et Julka ».) Le prince si tranquille, tout habité du souci de ses sujets dans son petit pays, ne voit rien de ces désirs, ne paraît pas sensible aux raisons qui amènent la femme de l’artiste près de lui. Il y est indifférent. C’est cette indifférence qui transforme la femme, car… « il y a dans l’année des jours où une femme ne peut se contenter d’un regard. Le nombre de ces jours n’est pas inscrit dans nos livres, car il n’est pas le même chez toute femme. Mais chez toutes ils existent. » Qui blâmera-t-on dans ce conte ? Le prince aux yeux tristes ou la femme aux désirs impérieux ? Que chacun choisisse, sans doute. Ou ne choisisse pas.
Le vainqueur
Il ne s’agit plus de visiteur. On est ici dans l’esprit d’un personnage, un personnage épuisé, presque mort dirait-on, prêt à s’effondrer en tout cas juste après un acte douloureux. Un acte héroïque : l’esprit dans lequel nous sommes est celui d’un héros, fêté par les siens, porté en triomphe, admiré et chanté, tout cela il le perçoit à travers la douleur et l’épuisement. Au bout de son bras, la tête tranchée de Goliath ; autour de lui les clameurs des Juifs et celle des armes que les Philistins abandonnent en fuyant. C’est donc cela, être un héros ; au héros l’acte épuisant, la souffrance, les plaies, l’inconscience, aux autres le triomphe, la liesse.
Au crépuscule
Le scribe de la légation bosniaque, Drazeslav, écoute les conseils du médecin. Pensées d’un atrabilaire sur sa situation et son environnement, et revirement final de son état d’esprit. Au crépuscule d’une journée bosniaque.
Deux écrits du scribe bosniaque Drazeslav
Ces deux écrits font suite au texte précédent. Le second s’achève d’ailleurs sur les mêmes mots que « Au crépuscule » : « Ainsi, hésitants et inconséquents comme nous sommes, la vie nous leurre, nous exalte et nous déçoit. Ainsi, la terre et la mer nous donnent l’un à l’autre, nous émiettent, nous usent et nous polissent, sans but ni raison perceptibles. » (p. 170, à comparer avec la p. 160)
Le premier écrit concerne les Ragusains, que le délégué bosniaque a appris à connaître en les côtoyant, et dont il dresse ici le portrait. Portrait d’un peuple « amphibie », un pied sur terre, un autre sur mer, toujours, en toutes choses, capables de tout faire et difficiles à suivre pour les étrangers, mais aussi incapables de sincérité, tout entiers définis par et tournés vers l’argent, seule valeur stable dans ses fluctuations.
Le second détaille les sentiments qui se font jour et se succèdent dans l’esprit de celui qui quitte son pays natal pour se rendre dans un autre. Le malaise qu’il ressent à s’éloigner de son pays, et le malaise qu’il ressent à y revenir après avoir connu l’autre. Le départ est ouverture et en même temps culpabilité envers le pays qu’on laisse. « Et ce sentiment de dette et d’obligation qui s’accumulent, envers une terre en quelque sorte trahie, se dépose en nous et se transforme, avec le temps, en un constant abattement. » (p. 166) Mais le retour est lui aussi coupable, comme si on laissait derrière soi une promesse non suivie, et qu’on restait d’une certaine manière irrémédiablement infidèle au pays qu’on a quitté.
Le texte s’achève sur le constat de l’illusion et de l’inconstance. La vie n’est qu’un leurre.
Même s’il fait référence à la Bosnie et aux Ragusains, réels, ce texte, comme « Le vainqueur », peut se lire aussi comme un texte coupé de tout ancrage réel. On y sent alors la même « universalité » que dans un texte de fantasy, le Retour au pays de Robin Hobb par exemple.
Conversation du soir
C’est d’abord un texte sur la vallée de Sarajevo, sa partie haute et sa partie basse, et l’étrange silence dans lequel retombe toute chose. Certain bruit continu n’est que le silence dans lequel tombent les autres bruits. Il y a alors dans ce silence quelque chose de charmant et d’oppressant à la fois. « Le silence règne dans ce quartier, et quand un son plus fort, inhabituel, se fait entendre, il sert surtout à mesurer la profondeur du silence qui tôt ou tard le recouvre et l’éteint. » (p. 172)
Puis deux amis, deux Ibrahim, discutent, comme souvent, en se promenant jusqu’à une fontaine contre le mur d’une mosquée, près de laquelle ils s’asseyent et parlent. Parlent ? En fait ce que dit Skaro, le Bosniaque, resté là toute sa vie, évoque ce chuintement dans lequel se perdaient les histoires de la vieille Zouya. Un marmonnement inintelligible, dont pourtant, si l’on écoutait bien, si l’on se laissait bercer, se détachaient des histoires. Des histoires que l’on entendait, si comme dans un rêve. Ainsi Stamboliya, l’autre Ibrahim, celui qui, parti étudier à Istanbul, y est devenu fonctionnaire et en est revenu comme « connaisseur des hommes » au service du vizir – ainsi Stamboliya l’écoute, et réussit à comprendre certaines parties de son discours, certaines seulement, le reste étant incompréhensible. Pourtant la question de Stamboliya est simple : il veut savoir ce qui se passe, il veut savoir pourquoi la Bosnie est si rétive au pouvoir du sultan. Et Skaro ne peut lui répondre. Il répond par des histoires qui sont autant de paraboles, mais répondre directement, clairement, il ne peut pas. Ce qu’il dit est comme le son continu de l’eau qui constitue le silence, le fond sonore sur lequel se détachent tous les bruits à Sarajevo. C’est aussi difficile à comprendre que le pays lui-même. Et Stamboliya s’impatiente, se force à rester calme, à écouter. Et Skaro avoue son impuissance, son incapacité à savoir, l’incertitude qui le saisit dès qu’il essaie de dire une certitude. Il ne sait pas, il ne sait rien.
Retenir la parabole du sang qui, libre autrefois, fut enfermé dans les veines des hommes et des animaux pour leur donner vie, et qui depuis se révolte, cherche à sortir, et fait que les hommes et les bêtes s’affrontent, versent le sang, irrémédiablement (p. 175). Et la parabole du petit cheval bosniaque qui avance mal chargé, et que l’on n’a pas le temps de mieux charger (p. 176-177).
Sarajevo
C’est une ville. Le texte est construit sur cette anaphore. Il emplit ces mots de sens, un sens pris dans l’Histoire, qui se lit dans le visage même de cette ville.
« Entre les vergers escarpés, si souvent chantés, qui gravissent les pentes des collines, se déversent, comme autant de minces coulées de neige, les blancs cimetières musulmans d’autrefois, si caractéristiques. (Je ne sais par quelle illusion des sens, ou quelle insondable logique j’ai toujours eu l’impression que les vergers escaladent les hauteurs et que les cimetières les descendent.) » (p. 185)
« Ces deux types de rues sont encore nettement distincts, tels les alphabets de deux écritures et langues différentes. Mais le voile du crépuscule, qui va s’épaississant, les confond, les unit dans le conte indistinct de cette nuit qu’ils partagent, et qui recouvre maintenant histoires et légendes, exploits des conquérants étrangers, des petits et des grands tyrans autochtones et de l’oligarchie, soulèvements populaires, longs règlements de comptes obscurs entre ceux qui ne possèdent et ne donnent rien, et ceux qui n’ont pour tout bien que leur indigence. » (p. 186-187)
« Une ville est là. Une ville qui, en même temps, se transforme, agonise et renaît. » (p. 187)
Thierry LE PEUT


