GIOCONDA, de Nikos Kokantzis
Athènes, 2011 (écrit en 1975) – Editions de l’Aube, 2014
Traduit du grec par Michel Volkovitch
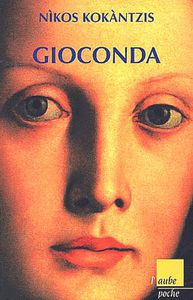

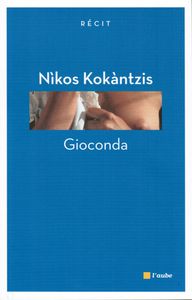
Gioconda est l’unique récit de Nikos Kokantzis. Il l’a écrit à quarante-cinq ans, trente ans après les faits qu’il rapporte. Les faits : car il s’agit d’une histoire vraie. Celle d’un amour vécu intensément durant quelques semaines, et brutalement interrompu. C’était durant la guerre, à Thessalonique. Le jeune Nikos, adolescent, découvre l’amour – et notamment l’amour physique, que l’auteur décrit ici sans fausse pudeur, en insistant précisément sur la découverte des sensations – avec Gioconda, son amie depuis l’enfance. Gioconda est juive. Bientôt les Juifs seront déportés à Auschwitz, et très peu en reviendront.
Gioconda présente donc l’ambivalence d’une histoire d’amour intense se déroulant presque dans un rêve, avec la guerre en « simple » toile de fond, et de l’un de ces drames de la déportation qui hantent la littérature d’après-guerre. Le dénouement en est sans appel, et pourtant la guerre n’empêche pas cet amour de s’épanouir presque sans limite. C’est la beauté de ce petit livre d’allier ainsi la pureté d’une ouverture à l’amour et aux sens et la brutalité d’une guerre qui, ici, ne parvient pas à recouvrir l’amour. Malgré le dénouement, la lumière est plus forte que l’ombre, et c’est cet éclat qui enveloppe le lecteur. « Chaque jour nous étions plus forts que la guerre », se souvient le narrateur. « Car quand la guerre n’existe pas aux yeux d’un homme, elle est déjà vaincue. » (p. 47)
Il y a quelque chose d’idéal dans l’ouverture « classique » du récit. Comme si Daphnis et Chloé rencontrait Les souffrances du jeune Werther : un mélange de simplicité et d’idéalisme dans la peinture des personnages, bientôt contrebalancé par une « tempête intérieure » qui annonce l’ombre de la déportation mais qui reste, avant tout, un exemple de tourment psychologique concentré dans l’esprit du narrateur (1). Kokantzis offre là de belles pages décrivant la prise de conscience de l’amour à travers les affres de la jalousie, et l’injure qui occupe le centre de ces pages, le « sale juif » lancé à un rival, s’il nous rappelle le contexte du récit et annonce le drame de la déportation, n’en balaie pas pour autant la peinture du tourment amoureux, qui reste ici l’essentiel.
Lorsqu’ensuite le malentendu se dissipe, que la tension de la rancœur et de la culpabilité disparaît, c’est l’amour qui s’éploie, et de nouveau le drame à venir, s’il est bien là, n’enlève rien à la finesse des observations sur l’amour lui-même, décrit ici comme un sentiment et comme une richesse de sensations dont le sexe n’est pas exclu, ou recouvert d’un voile pudique. Il s’exprime au contraire ouvertement, dans des pages de nouveau très belles, où la guerre n’occupe toujours que le second plan. La menace qui plane, et l’annonce du dénouement inéluctable, ne rend que plus intense l’expérience de l’amour entre deux adolescents.
C’est cela que réussit ce récit : nous entraîner, par une adhésion totale au point de vue du jeune narrateur, dans l’âme d’un adolescent qui découvre l’amour. Donner à cette expérience la prééminence sur le Mal, garder à l’amour sa lumière et son intensité en dépit du contexte. C’est cette lumière qui s’impose d’emblée, dès les premières pages, à travers l’image persistante, par-delà les années écoulées, d’un sourire : « Elle fut mon amie la plus proche depuis que nous sûmes parler jusqu’au jour où elle partit, à quinze ans, avec toute sa famille, emmenée par les Allemands. Deux ans avant cette séparation, elle fut la première femme qui me lança un sourire, de façon soudaine, imprévue, un sourire différent de tous ceux que j’avais connus jusqu’alors, et dont elle-même devait ignorer le sens, en levant les yeux jusqu’aux miens quelques instants, dans la pénombre d’une soirée de printemps, tandis que nous étions debout, vaguement mal à l’aise, sous l’abricotier de son jardin – un sourire timide, fugitif qui m’emplit d’un trouble, d’un vertige inconnus. » (p. 13-14)
Gioconda s’offre comme un hommage à la jeune fille disparue, mais aussi une ode à l’amour. Si la lumière y domine, c’est qu’elle a pour fonction d’éclairer la vie entière de l’adolescent qui a survécu, et, peut-être, les derniers moments, à jamais ignorés, de Gioconda : « dans ce temps si bref se concentraient le plaisir et l’émotion d’heures et de jours entiers qui, nous ne le savions pas encore, allaient donner un sens à notre vie, et remplir le vide laissé par mon amie quand elle serait partie à jamais. Je m’en souviens avec la plus profonde reconnaissance et je prie pour que le cauchemar des derniers mois de sa vie ait été adouci, ait perdu un peu de son horreur, grâce aux souvenirs de ces instants, à la plénitude de notre vie pendant ces derniers mois terrifiants et magiques. Je ne le saurai jamais. » (p. 71-72) L’ignorance irréductible des derniers moments de la disparue a besoin de ce récit pour compensation, pour que l’espoir tienne en échec le désespoir. La littérature ici se substitue au réel, car de Gioconda, de sa vie, des lieux où elle a vécu, il ne reste que ce récit, tout le reste, nous révèle le narrateur au terme du livre, « tout a disparu sans laisser de traces » (p. 120)
« Gioconda n’est plus qu’un rêve », note-t-il encore. « Parfois je me demande si elle a existé, j’interroge mes parents, mes cousins, pour m’assurer que oui. » (p. 120) Que reste-t-il finalement pour nous dire que Gioconda a existé, et que ce récit n’est pas un rêve ? La foi, uniquement. Celle qui guide la plume de l’écrivain lorsqu’il assure à la femme aimée une pérennité par le souvenir et par les mots – celle qui habite le lecteur quand il ouvre le livre. Il n’en faut pas plus pour faire exister le rêve.
Thierry LE PEUT
(1) Un tourment « anti-romantique » cependant car, au contraire de ce qui arrivait aux âmes éperdues du XIXe siècle, le tourment intérieur du narrateur contraste ici avec le monde extérieur, qui reste calme : « Un peu plus loin dans l’eau, des barques de pêcheurs se balançaient voluptueusement côte à côte, tout sentait la mer et les algues sèches, tout était tranquille, à part moi. » (p. 31)


