DE MA PRISON, par Taslima Nasreen
Philippe Rey, 2007 - Points, mars 2010
L'échec de la démocratie
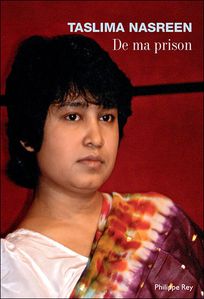 De novembre 2007 à mars 2008, Taslima Nasreen, écrivain d’origine bengalie, est « assignée à résidence » par le gouvernement indien. D’abord assignée dans son appartement du Kolkata, au Bengale-Occidental (l’une des provinces d’Inde), elle est ensuite déplacée dans une chambre de Delhi, où elle est sous surveillance constante, n’a le droit ni de sortir ni d’ouvrir la fenêtre, ne reçoit aucune visite sinon sur approbation expresse du gouvernement et dans des conditions rédhibitoires. Officiellement, le gouvernement la protège de fondamentalistes qui ont menacé de la tuer ; il se protège également lui-même, car ces mêmes fondamentalistes ont menacé de créer des troubles, de fomenter des émeutes. Mais Taslima Nasreen se sent prisonnière, et elle l’est en effet, même si elle est confinée dans une chambre d’hôtel et non dans une prison. Ayant conservé son ordinateur et un accès à Internet, elle peut rester en contact avec le monde extérieur, à condition de ne rien révéler de l’endroit où elle se trouve ni des conditions particulières de sa « protection » - d’ailleurs, elle ignore l’endroit exact où elle est ainsi « gardée ».
De novembre 2007 à mars 2008, Taslima Nasreen, écrivain d’origine bengalie, est « assignée à résidence » par le gouvernement indien. D’abord assignée dans son appartement du Kolkata, au Bengale-Occidental (l’une des provinces d’Inde), elle est ensuite déplacée dans une chambre de Delhi, où elle est sous surveillance constante, n’a le droit ni de sortir ni d’ouvrir la fenêtre, ne reçoit aucune visite sinon sur approbation expresse du gouvernement et dans des conditions rédhibitoires. Officiellement, le gouvernement la protège de fondamentalistes qui ont menacé de la tuer ; il se protège également lui-même, car ces mêmes fondamentalistes ont menacé de créer des troubles, de fomenter des émeutes. Mais Taslima Nasreen se sent prisonnière, et elle l’est en effet, même si elle est confinée dans une chambre d’hôtel et non dans une prison. Ayant conservé son ordinateur et un accès à Internet, elle peut rester en contact avec le monde extérieur, à condition de ne rien révéler de l’endroit où elle se trouve ni des conditions particulières de sa « protection » - d’ailleurs, elle ignore l’endroit exact où elle est ainsi « gardée ».
Les textes réunis dans De ma prison sont ceux qu’elle a écrits durant cette période. Tenue dans l’ignorance des véritables motivations de ses « protecteurs », gardée à l’écart de ses amis et de sa famille, consciente 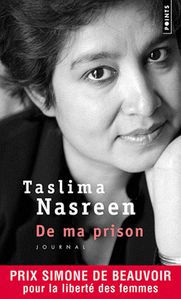 que son sort n’intéresse guère qu’une poignée de personnes, une fois passé l’intérêt médiatique, Taslima Nasreen se confie à son ordinateur. Elle s’efforce de raconter, de comprendre, écrit des poèmes traduisant son sentiment d’emprisonnement, de déception, d’abandon et de trahison, rédige une communication à l’adresse du jury du prix Simone de Beauvoir, que lui décerne la France et qu’elle ne peut recevoir personnellement. Il ne s’agit pas ici de textes rédigés après coup, avec le recul, mais sur l’instant, au cœur même de l’émotion. On y sent une Taslima Nasreen tantôt déterminée, tantôt abattue, consciente du travail de destruction que sa situation opère en elle. D’abord sûre de son droit, décidée à ne pas céder à ce qui apparaît très vite comme un chantage du gouvernement, l’écrivain doute, puis sent sa détermination céder à mesure que son isolement se révèle sans issue. Seule, que peut-elle contre un gouvernement ? Que peut son désir de vérité contre le mensonge, la lâcheté, le chantage et surtout le formidable pouvoir de la machine gouvernementale ? Ce sont ces sentiments qui s’expriment à mesure que passent les semaines, puis les mois, et qu’aucun secours ne vient y répondre ; pire : lorsque sa santé fragile la conduit aux portes de la mort, Taslima Nasreen réalise qu’elle pourrait bien, en effet, mourir dans l’indifférence générale. Voire, que sa mort serait une issue peut-être commode pour ses « geôliers ».
que son sort n’intéresse guère qu’une poignée de personnes, une fois passé l’intérêt médiatique, Taslima Nasreen se confie à son ordinateur. Elle s’efforce de raconter, de comprendre, écrit des poèmes traduisant son sentiment d’emprisonnement, de déception, d’abandon et de trahison, rédige une communication à l’adresse du jury du prix Simone de Beauvoir, que lui décerne la France et qu’elle ne peut recevoir personnellement. Il ne s’agit pas ici de textes rédigés après coup, avec le recul, mais sur l’instant, au cœur même de l’émotion. On y sent une Taslima Nasreen tantôt déterminée, tantôt abattue, consciente du travail de destruction que sa situation opère en elle. D’abord sûre de son droit, décidée à ne pas céder à ce qui apparaît très vite comme un chantage du gouvernement, l’écrivain doute, puis sent sa détermination céder à mesure que son isolement se révèle sans issue. Seule, que peut-elle contre un gouvernement ? Que peut son désir de vérité contre le mensonge, la lâcheté, le chantage et surtout le formidable pouvoir de la machine gouvernementale ? Ce sont ces sentiments qui s’expriment à mesure que passent les semaines, puis les mois, et qu’aucun secours ne vient y répondre ; pire : lorsque sa santé fragile la conduit aux portes de la mort, Taslima Nasreen réalise qu’elle pourrait bien, en effet, mourir dans l’indifférence générale. Voire, que sa mort serait une issue peut-être commode pour ses « geôliers ».
L’expérience de Taslima Nasreen, ici relatée au fil des semaines, est effrayante. Elle démontre combien il est facile de réduire une voix au silence, de briser la volonté d’un individu, même à une époque de « communication totale ». On est surpris par le silence qui entoure l’écrivain ; certes, des intellectuels prennent sa défense, mais dans la solitude de sa « prison dorée » l’écrivain se sent pourtant abandonnée. « La presse semble avoir perdu tout intérêt pour la situation, sans précédent pourtant, qui est la mienne ; quant aux médias électroniques, ils m’ont abandonnée », écrit-elle en mars 2008. Convaincue d’abord qu’elle a « les masses » de son côté, que beaucoup de gens l’aiment, intellectuels mais aussi femmes de la rue, qui ont lu ses livres, elle réalise à quel point ce soutien pèse peu face à la volonté d’un gouvernement. Condamnée à l’exil de son Bangladesh natal, elle avait cru trouver au Bengale-Occidental un refuge ; la possibilité enfin de vivre chez elle, sur une terre à laquelle elle se sent appartenir, une terre qui nourrit son être et sa langue (elle écrit en bengali). Voilà que des menaces proférées par des fanatiques mettent à genou un gouvernement entier, et que ce gouvernement s’emploie, non à combattre le fanatisme et le terrorisme, mais à faire disparaître la victime de ce fanatisme ! Peu à peu, c’est donc de son propre pays, de son peuple, que doute Taslima Nasreen. Qu’est-ce donc qu’une démocratie où un gouvernement puissant n’ose pas s’opposer au terrorisme ? Une démocratie qui, parce qu’elle convoite le vote des fanatiques, leur abandonne le pouvoir réel et cède à des exigences scandaleuses ?
« Je trouve très difficile de croire », écrit Taslima Nasreen, « que Pranab Mukherjee – qui est le deuxième ministre en ordre d’importance dans le cabinet indien et le ministre des Affaires étrangères d’une nation d’un milliard d’habitants qui espère devenir une superpuissance dans un avenir proche – ne peut donner refuge à un écrivain exilé sans défense qui a perdu son pays et sa famille, au prétexte qu’il subir des pressions de quelques fondamentalistes ici et là. Toute cette affaire paraît surréaliste. Mais les fondamentalistes représentent un électorat important, or il faut des voix pour se maintenir au pouvoir. »
Comment réagit-on lorsque le surréaliste devient la réalité ? Lorsque des gens que l’on considérait jusqu’alors comme des amis, des alliés, des intellectuels droits et indépendants, se résignent, se détournent, voire deviennent hostiles ? Lorsque, condamné à l’isolement pour avoir écrit la vérité, sans désir de provocation, on est traité comme un paria et abandonné par le monde entier ? Lorsque, n’ayant commis aucun crime, on est pourtant désigné comme responsable d’une violence non pas avérée mais redoutée ? Vous recevez des menaces mais ce n’est pas l’auteur de ces menaces que les autorités sanctionnent, c’est vous-même, pour votre sécurité, dit-on. « Ce n’est plus contre les fondamentalistes que je me bats, mais contre le gouvernement indien », écrit l’écrivain en février 2008. Lorsque, lors d’une visite officielle en Inde, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, demande à remettre personnellement le Prix Simone de Beauvoir à l’écrivain, le gouvernement indien s’y oppose, et la France s’incline. Pour Taslima Nasreen, la solitude devient absolue ; bientôt, contrainte de se rendre à l’hôpital pour des problèmes cardiaques, elle manque mourir, pourtant ses « gardiens » n’hésitent pas à la faire sortir de l’hôpital pour la conduire auprès du ministre Pranab Mukherjee, qui tente encore de la convaincre de quitter le pays et d’aller en France recevoir son prix.
Si la situation de Taslima Nasreen est d’abord politique, son journal de « captivité » livre également le point de vue de l’individu. Les rencontres avec des personnalités politiques, l’incompréhension et le reproche qu’elle sent chez elles, l’impossibilité de voir ses propres amis (pour les rencontrer, elle doit faire une demande au gouvernement, qui prend son temps pour l’étudier ; si la demande est acceptée, l’écrivain sera conduit dans un lieu secret à l’intérieur d’une voiture aux vitres teintées, et l’ami sera soumis au même mode opératoire), la déception ressentie devant la défection de ceux qu’elle tenait pour ses amis, mais aussi les aspects domestiques de la captivité : l’interdiction de sortir, d’ouvrir la fenêtre, le thé insipide apporté chaque matin – et qu’il faut boire froid à la fin de la journée -, l’impossibilité de se laver. Autant d’élements qui peuvent faire dire à un correspondant, dont Nasreen lit le message sur Internet, qu’elle devrait se sentir honteuse de se plaindre alors que bien des femmes en Inde vivent dans la misère ; et, en effet, comparées aux conditions de détention en prison, celles qui sont imposées à l’écrivain sont douces. Mais Taslima Nasreen n’est pas une criminelle. Elle n’est pas détenue pour une faute mais, lui dit-on, pour sa protection. Sa situation est celle d’une citoyenne, dans une démocratie laïque, à qui l’on retire brusquement sa liberté de mouvement, sa liberté de parole. Un matin, prévenue de la visite d’un « responsable » dont on refuse de lui dire le nom, elle écrit : « Je me regarde dans le miroir pour voir ce qu’il va voir : quelqu’un qui n’a pas changé de vêtements, n’a pas pris de douche depuis plus d’une semaine, pas coiffé, la peau toute desséchée. Est-ce moi ? » En effet, quelle coquetterie de la part d’une prisonnière. Mais c’est une femme qui n’a commis aucun crime qui se voit imposer par son gouvernement ce traitement humiliant. Il ne s’agit pas seulement d’une affaire politique : il est question d’identité, et de la manière dont on peut, très simplement dès lors qu’on en a le pouvoir, priver une personne de son identité, de ses certitudes, en commençant par toucher à sa dignité. On se souvient alors, même si l’on ne veut pas céder à des rapprochements disproportionnés, que la violence faite au corps était l’un des moyens mis en œuvre par les nazis pour retirer aux Juifs la plus élémentaire dignité humaine.
Une telle chose est-elle possible dans une démocratie ? Taslima Nasreen veut croire que non. Elle se trompe. Au terme de cinq mois, elle cède. Elle quitte l’Inde pour l’Europe, où pourtant elle n’avait nulle part où aller. Chassée du Bangladesh, puis de l’Inde, « exilée intérieure » dans son propre pays, elle en est aujourd’hui bannie. C’est la réponse trouvée par une « grande démocratie » au terrorisme fondamentaliste.
Thierry LE PEUT


