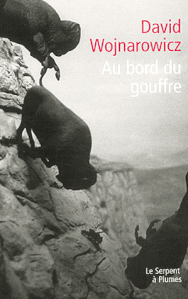 JE VOUS REVEILLERAI POUR VOUS ACCUEILLIR DANS VOTRE CAUCHEMAR
JE VOUS REVEILLERAI POUR VOUS ACCUEILLIR DANS VOTRE CAUCHEMAR
La colère de David Wojnarowicz est celle d’un homosexuel dont les amis meurent du sida, aux Etats-Unis, dans les années 1980. Elle devient celle d’un homme lui-même touché par la maladie, qui l’emportera en 1992. C’est une colère contre « l’état » (sans majuscules, comme les noms de villes et les noms d’états, comme le nom de l’amérique), contre une société oppressive et criminelle qui se dit – et est perçue comme – démocratique. Contre, en particulier, certains « pro-nazis » déguisés en hommes politiques et en hommes d’église, que l’artiste accuse de façon récurrente d’être en partie responsables de la propagation de la maladie par leur inertie et leur refus de prendre en compte et la maladie et les malades, non par incurie mais par idéologie. Les noms du cardinal O’Connor, de William Dannemeyer (républicain californien) ou d’Edward Koch, maire de New York de 1978 à 1989, vous deviendront familiers au fil de la lecture des différentes textes réunis par le Serpent à Plumes sous le titre Au bord du gouffre en 2005.
Artiste polyvalent, né dans le New Jersey en 1954, ayant passé une partie de son adolescence dans la rue, David Wojnarowicz fut peintre, photographe, sculpteur, vidéaste, performer, écrivain. Ses écrits disent surtout qu’il essaya de capter l’essence de sa vie et de la restituer à son temps, convaincu qu’il donnait ainsi à entendre une voix singulière qui, s’ajoutant à toutes les voix singulières, aiderait ses contemporains à comprendre qu’ils n’étaient pas seuls, et que le discours standardisé fabriqué par les politiques et par les médias n’était pas « la réalité ». Cette réalité, celle de la rue, celle du village, celle des hôpitaux rebaptisés « entrepôts de la mort » au plus fort de l’épidémie de sida, Wojnarowicz lui ouvre ses pages avec la conscience d’un militant, d’un homme qui se bat contre la surdité et le silence. Au bord du gouffre contient le texte d’une conférence, le journal d’un sidéen, celui d’un ami de sidéen qui voit son compagnon mourir, des réflexions sur l’Amérique, des souvenirs d’enfance croisés des expériences d’adulte, et un texte qui se veut un hommage à un ami suicidé dont les textes ont été détruits par sa famille, mais qui laisse entendre plusieurs voix, proposées sous forme de transcriptions d’entretiens, de confidences recueillies et ensuite transmises pour permettre au mort de continuer d’exister malgré l’effacement dont il a été victime.
La couverture de l’édition est une photographie de Wojnarowicz montrant des bisons qui se précipitent dans le vide. L’image va plus loin que le titre (Au bord du gouffre) et elle va au-delà de l’écrivain ; c’est l’image du monde tel qu’il le voit. A la fois l’image d’un troupeau qui fonce en direction de la mort et celle d’une fatalité, avec l’aveuglement, la folie, l’inéluctabilité que celle-ci suppose.
L’image du monde qu’exprime Wojnarowicz est liée à l’enfance qui fut la sienne. L’adulte soumis à des autorités qui l’oppriment est le prolongement de l’enfant impuissant. « Chaque photo, chaque sculpture, chaque film ou chaque texte illustre pour moi un moment précis de l’histoire de mon corps sur cette planète, en amérique. Ainsi chaque photo, chaque film, chaque sculpture et chaque texte que je produis a germé dans un état d’esprit particulier que moi seul connais, sachant que je me suis toujours senti ostracisé dans ce pays et qu’ainsi j’ai toujours vécu en ayant l’impression d’être le spectateur de ma propre vie. Du plus loin que je me souvienne, il me semble que j’ai toujours eu cette sensation – depuis l’enfance où il y avait en guise de Chefs d’Etats ou de Politiciens les Chefs de Famille : Maman et Papa. A l’extérieur du foyer familial, Maman et Papa étaient détrônés par le Professeur, le Gendarme, l’Epicier, le Propriétaire, le Voisin, le Curé, Dieu, le Policier, le Flic en Civil, le Psychiatre, l’Homme Politique, le Président. Il m’a toujours semblé que la plupart des habitants de ce pays éprouvent une sorte de soulagement lorsque les Chefs d’Etat succèdent aux Chefs de Famille. C’est l’impression que ça me fait et je crois qu’elle est juste car les gens ne paraissent jamais vouloir me détromper. Mais j’ai peut-être tort. Le temps passant, j’en arrive à penser que le monde n’est pas nécessairement tel qu’il apparaît lorsqu’on juge ce qu’il tait ou ce qu’il cache. » (p. 169-170)
L’ensemble des écrits réunis ici illustre ce propos. La pratique artistique de Wojnarowicz est un « art de vivre », au sens où ce qu’il exprime est ce qui le définit en tant qu’être humain. Il ne se place pas dans un courant, il ne s’interroge pas (ici, du moins) sur la nature ou la finalité de l’art, il traduit simplement en objets, en écrits, sa propre vie et son propre regard sur le monde. (D’aucuns diront que c’est la nature même de l’art, mais je ne vois pas l’intérêt ici de discuter une objection aussi naïve.) Si une partie de ces objets, de ces écrits, concerne la vie sexuelle de l’auteur, ce n’est pas provocation : « Ce que d’aucuns qualifient de ‘pornographie’ n’est tout simplement qu’un document historique d’une grande richesse témoignant d’une diversité sexuelle gommée de la surface du monde pendant des siècles par les religions. » (p. 168) A l’époque où parle Wojnarowicz, la « culture populaire », à commencer par la télévision, n’a pas encore accompli cette mutation qui lui fera assumer la diversité de son public et proposer une vaste galerie de figures homosexuelles ; Wojnarowicz ne peut donc trouver dans cette représentation de la société américaine un écho à sa propre vie et à celle de son entourage, et le sentiment d’oppression n’en est que plus fort. L’idée d’une diversité sexuelle « gommée de la surface du monde » rejoint la réaction liminaire du récit « Suicide du type qui un jour fabriqua un sanctuaire sophistiqué au-dessus d’un trou de souris », réaction contre l’effacement subi par l’ami mort, Dakota, dont tous les écrits, témoignages de l’homme qu’il fut, ont été détruits par sa famille qui, conformément à la loi, les avait hérités, et dont les lettres encore en possession de ses amis ne peuvent pas davantage être publiées sans l’autorisation de la famille. Sommet de la dépossession et de l’oppression dont un individu peut être victime, l’effacement total de son existence par l’alliance de la loi et de la famille.
Les fenêtres que Wojnarowicz ouvre sur son passé, et spécialement sur son enfance, comptent parmi les visions d’horreur de ses textes. A commencer par l’extrait reproduit en quatrième de couverture, scène de cauchemar dont on ne sait pas si elle eut réellement lieu, mais qui restitue cette horreur imprimée dans l’enfance : « La nuit en songe je rampe sur des pelouses fraîchement tondues, je contourne les statues et les chiens et les voitures qui surveillent votre geôle. Je m’introduis dans vos maisons par les plus infimes fissures des briques qui vous procurent un sentiment de confort et de sécurité. Je traverse vos salons et grimpe vos escaliers et je pénètre dans vos chambres à coucher. Je vous réveille pour vous raconter ce qui m’est arrivé lorsque j’avais dix ans, un jour que je rôdais autour de times square à la recherche d’un homme qui se coucherait sur moi pour me prodiguer les câlins et les baisers dont ma mère et mon père me privaient. Je me suis fait accoster par un type qui m’a emmené dans un coin reculé le long des quais et m’a roué de coups tant il avait peur des pulsions ardentes enfouies dans ses entrailles. J’aurais aimé l’étrangler mais mes mains trop petites ne pouvaient faire le tour de son cou. Je vous réveillerai pour vous accueillir dans votre cauchemar. » (p. 93-94) L’apostrophe au lecteur – qui culmine plus loin dans un « Pauvres cons » qui s’adresse directement à nous qui lisons les états d’âme de l’auteur (p. 231) – transforme cette vision en une scène archétypale, dénonçant la terreur qu’elle contient comme le cauchemar partagé de l’auteur et du lecteur. Il n’y est pas question de garçons à la dérive et de malades sexuels dans une atmosphère glauque, mais de la relation entre les pères et les enfants, de la démence et du refoulement qui sont nichés dans la société même, dans chaque individu, et perpétuellement reconduits.
Le cauchemar se retrouve dans les scènes plus « réelles » que livre l’auteur de sa propre enfance. Le père violent, incapable d’aimer sa femme et ses enfants, capable seulement de les battre, et qui finit par tourner contre lui-même sa colère en se pendant, tout en achevant d’imprimer dans ses enfants la violence qu’ils porteront ensuite toute leur vie, car c’est le plus jeune des fils qui trouve le corps pendu de son père. Désir d’amour, incompréhension, et cette autre scène qui exprime la tendresse dérisoire, terrifiante à sa manière, qui reste après tout cela : « Le seul acte de clémence dont je me souvienne de la part de mon père a eu lieu le jour où m’ayant emmené dans la salle de jeux pour me tabasser comme à l’accoutumée, il m’a demandé, juste avant de commencer, ce qu’il devait faire. Je lui ai répondu ‘Ne me frappe pas’. Je me souviens qu’il m’a regardé d’un air triste et las, a réfléchi quelques instants, et a lâché : ‘D’accord.’ » (p. 301-302) Et cette phrase, un peu plus loin : « Je rends leur humanité à mes parents en marque de déférence car ils ont été victimes de leurs propres parents. » (p. 315)
Quand on lit ce genre de choses, on est en droit de questionner la « vérité » de ce qu’écrit l’auteur. Témoignage ou complaisance ? ou les deux ? Pour moi, une question suffit pour résoudre ce doute : ce que je lis là existe-t-il ? La réponse est oui. Et bien pire. Et c’est ce qui permet de recevoir ces « confidences », fussent-elles fantasmées, comme un témoignage « vrai » du monde dans lequel nous vivons. Ce qui permet de laisser l’écho se répercuter dans nos propres vies de lecteurs, et de saisir dans l’expérience d’un auteur singulier ce qui concerne aussi la nôtre.
La complexité des êtres que Wojnarowicz dépeint vaut aussi pour les « méchants » qui, dans es textes, sont les tenants du pouvoir oppressif, celui des « élites », des riches blancs, des politiciens, des hommes d’église, tous ces gens dont la parole compte parce qu’elle est relayée par les médias et parce qu’ils ont le pouvoir d’en imposer les effets à l’ensemble de la population. Concernant la police de la sexualité, Wojnarowicz écrit : « Au fond, seul un individu tordu et sexuellement refoulé pourrait s’octroyer le ‘droit’ de dire à des adultes consentants qu’ils ne peuvent pas explorer leur propre corps. » (p. 168) Parole de bon sens qui traduit la colère de l’auteur devant les forces qui dirigent le monde en interdisant la libre existence des individus. La notion de liberté est souvent mise en question par Wojnarowicz, tout simplement parce qu’elle est loin d’aller de soi. Sa vision est bien sûr celle d’un individu « ostracisé », pour reprendre le mot qu’il utilise, mais cette colère peut être comprise même si l’on n’est pas, comme lui, un homosexuel (et a fortiori un homosexuel vivant aux Etats-Unis dans les années 1970-1980).
« Le paysage s’érode pièce à pièce et pour le remplacer je fabrique un monument fait de fragments d’amour et de haine, de tristesse et d’envies meurtrières. Ce monument est un sanctuaire dans lequel l’innocence se fait lentement ouvrir le ventre, son cœur est arraché, ses yeux énucléés, sa langue coupée, ses doigts brisés, ses jambes déchiquetées. » (p. 189-190) La colère, et la tristesse, de Wojnarowicz est celle d’un mourant ; pourtant, son cri est audible encore aujourd’hui, en dehors du contexte dans lequel il s’est élevé. La société américaine qu’il décrit est une société crypto-fasciste dont les bases n’ont au fond pas changé, mais qui surtout sont aussi celles de la société dans son ensemble (occidentale ? mondiale ?). Un fascisme soft, un fascisme démocratique, mais un fascisme dont la violence réelle est toujours sensible – même si pour le percevoir ainsi il faut, sans doute, prendre la place de ceux qui en sont victimes « directement ». « C’est épuisant de faire partie d’un peuple où les gens n’osent pas parler s’ils sont témoins d’événements qui ne les menacent pas directement. » (p. 301) A défaut de parler, chacun peut au moins écouter, et entendre.
Au bord du gouffre est un livre de mort dans lequel on entend pourtant un cri de vie. Les deux se mêlent dans les dernières pages, qui font écho aux thèmes du livre entier. Le « montage » parallèle d’une corrida et des souvenirs de l’auteur donne une force saisissante à cette dualité fondatrice des textes de Wojnarowicz. On en retiendra la symbolique de l’animal, écho à celle de l’albatros de Baudelaire. Mais aussi cette anaphore entêtante par laquelle l’écrivain adresse à son lecteur un message simple, souvent entendu, mais toujours puissant, d’autant plus ici qu’il est prononcé par un mourant : « Humez l’odeur des fleurs pendant qu’il en est encore temps. »
Thierry LE PEUT
AU BORD DU GOUFFRE de David Wojnarowicz
1991 - Serpent à Plumes, 2004
traduit de l'anglais par Laurence Viallet

David Wojnarowicz, Untitled (Falling Buffalo)

David Wojnarowicz, Untitled (One day this kid...)

David Wojnarowicz




